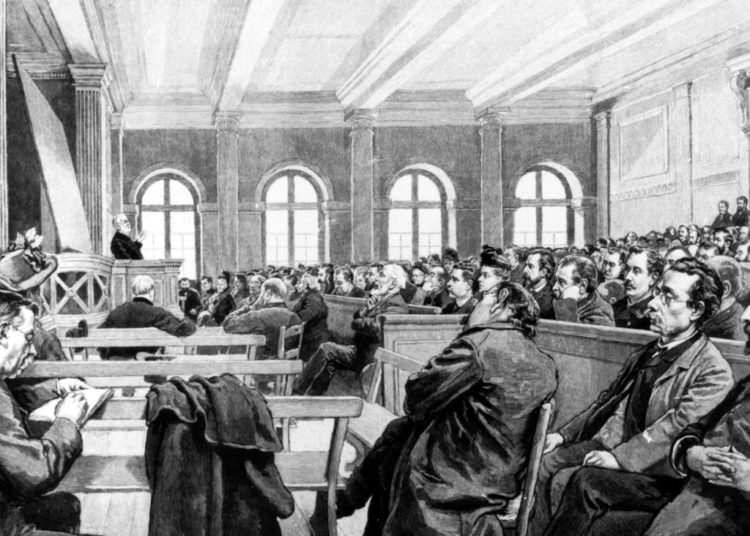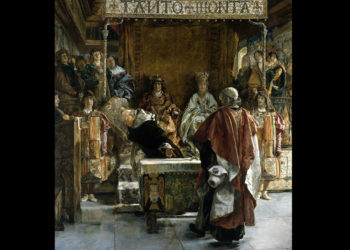Ornella Guyet, journaliste
Les 13 et 14 novembre 2025, à Paris, le Centre arabe de Recherches et d’Études politiques (Carep) accueille un colloque « déplacé ». Ce colloque intitulé « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » n’a pas pu se tenir au Collège de France, co-organisateur de la rencontre, pour des raisons de sécurité Les invités sont bien là ; le public, plus réduit, aussi, et les débats sont retransmis en direct sur les médias sociaux1L’intégralité des débats est accessible sur la chaîne YouTube du Carep : journée du 13 novembre / journée du 14 novembre 2025..
Le principal ordonnateur de l’événement, celui qui y a associé le prestige du Collège de France, est le professeur Henry Laurens, titulaire de la chaire d’Histoire contemporaine du monde arabe. Spécialiste du sujet, l’historien ne se distingue pas par sa neutralité. Le 13 novembre au matin, en ouverture du colloque, il explique avoir eu par le passé des liens avec des cadres du Hezbollah : « Je vais d’abord commencer par aggraver considérablement mon cas puisque en 2003, j’avais été un co-organisateur d’un colloque avec la succursale intellectuelle [sic !] du Hezbollah à Beyrouth. […] J’avais une salle complète de militants. […] M. Naïm Al-Qassem2Religieux, historien du Hezbollah, il est secrétaire général de ce mouvement depuis 2024. présidait ma séance. » Nous voici prévenus.
Le dernier livre d’Henry Laurens, Question juive, problème arabe3Henry Laurens, Question juive, problème arabe (1798-2001), une synthèse de la question juive de Palestine, Paris, Fayard, 2024.,dont le titre repose sur une citation de David Ben Gourion dont il est impossible de vérifier l’authenticité, ne contient pas une seule note de bas de page sur son millier de pages. Le politologue franco-israélien Denis Charbit en a rendu compte dans la revue Commentaire, par une recension sévère qu’il a intitulée, non sans humour, « Laurens d’Arabie »4Denis Charbit, « Laurens d’Arabie », Commentaires, n°191, automne 2025.. Il pointe le soutien de Laurens à la thèse depuis longtemps démystifiée d’une complicité entre sionistes et nazis dans les années 1930 et sa tentative de réhabiliter le Grand mufti de Jérusalem, Hajj Amin al-Husseini, compromis par ses liens avec le nazisme.
Surtout, Charbit interroge le rapport de l’historien à son objet, et le difficile équilibre entre l’exigence académique et les sympathies que l’on peut développer pour l’un ou l’autre « camp », et dont le colloque du Carep a été l’édifiante illustration :
« Le regard d’Henry Laurens sur le conflit est tendancieux en ce sens qu’il relate le point de vue israélien sans jamais le reprendre à son compte. Le plus souvent, il le présente d’une manière qui n’est pas flatteuse. Il tire de la thèse israélienne un argument peu convaincant et veille à ce que l’objection palestinienne soit percutante, apportant ainsi à la première le coup de grâce. Il est indulgent envers la cause arabe et palestinienne, insensible à celle d’Israël. Nous ne prétendrons pas que la chose est systématique, mais une petite musique est là qui s’insinue et persiste, parfois de manière appuyée, le plus souvent en sourdine5Denis Charbit, « Laurens d’Arabie », Commentaires, n°191, automne 2025.. »
Ce défaut de neutralité apparaît dans l’argumentaire même du colloque : « La question est de savoir si les États européens vont, dans leur grande majorité, reconnaître l’État palestinien et exercer des pressions envers l’État hébreu, en particulier dans le domaine de l’économie. » Si l’appel explicite au boycott d’Israël n’est pas officiellement formulé, il faut constater que sa « petite musique » servait de discret fond sonore à l’événement.
Soft power qatari
Outre Laurens, le « comité scientifique » comptait François Ceccaldi du Collège de France, ainsi que Leïla Seurat et Salam Kawakibi, directeur exécutif du Carep dont le journaliste Omar Youssef Souleimane a pu rappeler dans une récente enquête parue dans Marianne qu’il avait glorifié, en 2022, un Palestinien auteur d’une fusillade mortelle en Cisjordanie.
Le Collège de France et le Carep. Deux institutions en rien comparables. La première, prestigieuse, fait rayonner l’Université française au plan international ; la seconde est un outil du soft power qatari. Leïla Seurat donne des interviews à tonalité polémique dans Mediapart, quand ce n’est pas à des médias militants, comme la « revue de critique communiste » Contretemps, dans laquelle elle s’est entretenue avec Stathis Kouvélakis, autre universitaire militant. La chercheuse au Carep n’oublie pas d’y défendre le point de vue qatari. Le titre de celui publié dans Mediapart donne le la, aux antipodes de ce que l’on pourrait attendre d’une universitaire : « Le seul mode de négociation retenu par Israël, c’est l’assassinat ». Lorsqu’elle tente un décompte des « pays bombardés par Israël », Leïla Seurat n’oublie pas d’y inclure la Tunisie car, explique-t-elle au conditionnel, « l’attaque de drone en Tunisie sur la flottille en partance pour Gaza (…) pourrait être d’origine israélienne ». Le fait d’avoir publié cet article au lendemain de la supposée attaque n’excuse pas tout… puisque les autorités tunisiennes l’avaient démentie le jour même. Rigueur intellectuelle, quand tu nous tiens…
Outre le Carep, certaines institutions étaient très représentées dans ce colloque. C’était le cas de l’Université libre de Bruxelles (ULB), dont certains étudiants en droit se sont faits récemment remarquer en baptisant leur promotion « Rima Hassan », et qui ne comptait pas moins de quatre intervenants, avec Omar Jabary Salamanca, Álvaro Oleart, Jihane Sfeir et Thomas Vescovi. Il en est de même de l’EHESS, avec, notamment, Stéphanie Latte-Abdallah et Véronique Bontemps, toutes deux assumant de faire du lobbying au sein de leur établissement en faveur du boycott académique, comme l’une d’elles l’a expliqué à l’occasion d’une rencontre publique organisée par l’Association France Palestine solidarité (AFPS) des Bouches-du-Rhône.
La présence discrète mais importante de l’iReMMO
Cependant, l’ULB et l’EHESS restent des instances académiques. Il en va tout autrement de l’iReMMO (Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient), qui est un think tank réunissant des journalistes et des universitaires marqués à gauche. Agnès Levallois, modératrice du débat de clôture, qui a réuni Dominique de Villepin, Josep Borrell et Francesca Albanese, est présidente de l’iReMMO en même temps que chercheuse au CNRS. Henry Laurens lui-même est membre de son conseil scientifique ; François Ceccaldi siège à son conseil d’administration. La porosité entre les deux univers, universitaire et militant, est, là encore, une évidence. Pourtant, sur le programme du colloque, seule Agnès Levallois est mentionnée comme ayant des liens avec l’iReMMO.
« Institut de recherche », l’iReMMO joue sur les mots, puisqu’il n’entretient a priori aucun lien avec le CNRS ni avec aucune université française. Les seuls liens avec le champ académique sont interpersonnels. Il a compté ou compte au sein de ses équipes des personnalités connues pour leurs prises de positions antisionistes, parfois radicales : l’historien israélien Shlomo Sand, dont les travaux sur l’origine du peuple juif sont aujourd’hui largement remis en cause, est toujours membre de son conseil scientifique. Dominique Vidal, ancien journaliste au Monde diplomatique, y a siégé à au moins jusqu’en 2018. Il est en est de même de son ancien collègue Alain Gresh, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, aujourd’hui directeur de la revue en ligne Orient XXI et modérateur du panel 7, « Silencier les voix palestiniennes ».
Il semble que l’iReMMO ait aussi servi de tremplin vers le Carep, une organisation beaucoup plus récente, fondée en 2019 : ainsi, Salam Kawakibi, actuel directeur du Carep était auparavant administrateur de l’iReMMO, au moins jusqu’en 2018. Idem pour François Burgat, qui était au même moment dans son conseil scientifique avant d’intégrer celui du Carep. L’homme qui avait affirmé sur X, le 2 janvier 2024, qu’il avait « infiniment plus de considération pour les dirigeants du Hamas que pour leurs homologues israéliens », ne figurait pas au programme de ces deux journées.
Il est pour le moins étrange qu’un colloque initialement prévu au Collège de France accorde un tel crédit à ce think tank, confiant à sa présidente, Agnès Levallois, l’honneur de présider ès qualité le débat final avec les stars politico-médiatiques du moment. On le comprend mieux si l’on considère le Carep comme le véritable instigateur de l’événement, et non le Collège de France, qui ne servait là que de faire-valoir.
Universitaires, militants ou universitaires militants ?
La plupart des participants sont des universitaires ; tous ont, a minima, une formation universitaire. Nombre d’entre eux sont des militants. Cela n’aurait rien de problématique si leurs convictions personnelles n’impactaient pas autant leur travail et leurs discours, souvent engagés, qu’ils promeuvent sous couvert de leurs titres académiques. Beaucoup confondent, de fait, leurs convictions avec la réalité, lorsqu’il s’agit par exemple de décrire la guerre à Gaza comme « génocidaire », sans tenir compte d’analyses profondément divergentes qui existent sur ce sujet grave et des oppositions à cette thèse exprimées par d’autres universitaires. Il y a là une instrumentalisation du champ académique au profit du politique qui pose question.
Certains lient même explicitement les deux postures. Le sociologue canadien Michaël Séguin (panel 1) assume d’entrée une position engagée : « je ne serai pas nuancé. Pourquoi ne pas être provocateur, un peu ? Le but de la présentation va être au contraire de faire une lecture coloniale de l’histoire israélienne […] en faisant un détour par les colonial studies et un peu de pensée décoloniale. » L’écrivain Omar Jabary Salamanca, intervenant sur le panel 7 modéré par Alain Gresh, s’interroge : « Quelle est notre mission en tant que chercheurs militants, en tant qu’êtres humains, lorsque nous devenons témoins et donc complices involontaires du ravage d’un peuple ancien ? » Sur le même panel, l’écrivaine allemande d’origine palestinienne Hanna Al-Taher a, pour sa part, souhaité « partager [son] aspiration à devenir une universitaire anticolonialiste, ce qui est pour [elle] une véritable passion. […] Cela signifie lutter pour un avenir meilleur et plus beau pour nous tous. Au moins ces trois personnes assument-elles cette double casquette. Difficile d’en dire autant de tous les intervenants.
Toujours sur le panel 7, Thomas Vescovi est presque un cas d’école. Doctorant à l’EHESS et à l’ULB, il est surtout membre du bureau de l’Association France Palestine solidarité, une appartenance qu’il ne supporte pas se voir rappeler sur les plateaux télé. Il l’a écrit dans un texte colérique publié sur son blog, repris ensuite par le site de l’ « association de critique des médias » Acrimed. Familier des colonnes du Monde Diplomatique, d’Orient XXI, de L’Humanité ou de Mediapart, Vescovi a délivré le 14 novembre un discours qui tenait, sur le ton comme sur la forme, davantage du meeting que de la réflexion universitaire. Son inspiration était celle du chapitre qu’il a rédigé dans l’ouvrage collectif Gaza, une guerre coloniale sur le traitement médiatique du conflit, et dont Acrimed est l’une des principales références6Voir l’appareil de notes à la fin du chapitre « Les médias face à la guerre », in Véronique Bontemps et Stéphanie latte-Abdallah (dir.), Gaza, une guerre coloniale, Paris, Actes Sud, 2025., aux côtés d’Arrêt sur images, du Monde diplomatique, d’Orient XXI ou du blog de la gauche radicale Blast.
Pour certains, l’astuce consiste à se présenter comme « chercheurs indépendants ». C’est le cas de Vescovi dans l’article cité plus haut : « Peu importe les fantasmes de ces gens, le statut de « chercheur indépendant », c’est-à-dire d’activités de recherche effectuées en dehors d’un cadre universitaire, est le seul au nom duquel je peux m’exprimer dans les médias. Il n’y a aucune usurpation […]. Du reste, je refuse de me soumettre aux injonctions à justifier mon parcours ou ma légitimité. » De son côté, Mandy Turner (panel 3) est présentée comme une « autrice indépendante, chercheuse associée à Security in Context (International State Crime Initiative de la Queen Mary University of London), et au think tank ODI, spécialisé dans le développement et l’humanitaire. » Impressionnant sur le papier, en réalité fort douteux.
Boycott académique
On ne compte pas non plus les participants qui ont initié des pétitions dans leur domaines ou pays respectifs depuis deux ans contre « l’apartheid » et le « génocide » à Gaza, avec, souvent, des appels au boycott académique d’Israël.
Il en est ainsi de cet appel d’universitaires à « arrêter immédiatement le génocide et la guerre d’occupation » publié en janvier 2024 dans L’Humanité, signé par cinq panélistes : Stéphanie Latte Abdallah (4e position), Véronique Bontemps (26e), Jihane Sfeir (175e), Clara Denis Woelffel (977e) et Salam Kawakibi (1290e), auxquels il faudrait ajouter François Burgat (35e), au titre d’ancien président du Carep. Hanna Al-Taher, en Allemagne, a aussi compté parmi les initiateurs (3e position) d’une pétition visant à faire pression sur le gouvernement allemand pour qu’il place Israël sous embargo, pétition signée par Didier Fassin (Collège de France) ou encore par l’économiste Thomas Piketty.
Signataire de la pétition d’Al-Taher, le géographe Omar Jabary Salamanca (panel 7), a lui aussi publié son propre texte en compagnie de deux autres collègues. Il est sans doute l’appel le plus virulent des trois. Publié deux mois seulement après le pogrom du Hamas du 7 octobre 2023, ce texte intitulé « Déclaration contre le génocide et en faveur de la libération et du droit au retour du peuple palestinien » se concluait sur un appel au boycott d’Israël. Ses auteurs prenaient grand soin de s’y auto-absoudre de tout antisémitisme (« Nous rejetons tout amalgame entre les critiques adressées à l’État d’Israël ou à l’idéologie sioniste et l’antisémitisme »), tout en exigeant « la fin du génocide du peuple palestinien, du fleuve à la mer ».
Il va sans dire qu’aucun de ces trois textes ne faisait mention de la responsabilité du Hamas dans le déclenchement de la guerre à Gaza. Aucun n’appelait à libérer les otages.
Dans les faits, les appels au boycott académique pendant le colloque lui-même n’ont pas manqué, de la part d’Hanna Al Taher et d’Omar Jabary Salamanca en particulier, qui se sont tous deux montrés très éloquents dans leur critique de l’université, tout en défendant toutefois leur droit à y rester…
Fake news et BDS
D’autres encore ont des profils plus inquiétants. Shir Hever est l’un des rares dont l’engagement militant est mentionné dans le programme du colloque. Hever est présenté comme « un spécialiste de l’occupation, de l’apartheid et de l’industrie de l’armement en Israël. Titulaire d’un doctorat de la Freie Universität Berlin, il est membre de l’organisation Jewish Voice for a Just Peace », soit Jüdische Stimme, l’équivalent allemand de la très antisioniste Union juive française pour la paix (UJFP). Mais il est surtout l’un des fondateurs au plan international du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), qui constitue une pièce maîtresse dans la guerre hybride contre Israël. Il dit avoir croisé un cadre du Hamas en 2005 lors des réunions préparatoires.
Shir Hever publie principalement sur des sites et dans des revues militantes. Il ne rechigne pas à diffuser de fausses informations pour servir sa cause. Au colloque, il affirme « qu’il convient de mentionner la mitrailleuse lourde que les soldats israéliens utilisent encore aujourd’hui tous les jours sur le champ de bataille, appelée Minimi, qui est importée de France. » Pourtant, aucune mitrailleuse n’a été exportée par la France vers Israël, qui n’utilise pas ce modèle d’arme. Si le fait était avéré, il n’aurait d’ailleurs pas manqué de circuler largement sur les réseaux pro-palestiniens ! En réalité, la polémique a porté sur l’exportation par la France vers Israël d’éléments pouvant servir à fabriquer des munitions de mitrailleuses.
Pire : selon Hever, si Israël a refusé la demande des États-Unis d’exporter, via une usine israélienne en Allemagne, des missiles antichars Spike vers l’Ukraine, ce serait parce que ceux-ci ne fonctionneraient pas (ayant « été utilisés efficacement contre des maisons, des personnes, des voitures, mais jamais contre des chars »), et non parce que le pays cherchait à ménager sa relation avec la Russie en Syrie (ces faits datent de 2022) ! L’orateur a même conclu sur un ton complotiste : « Néanmoins, l’Allemagne vient d’annoncer un autre gros contrat pour acheter davantage de missiles Spike, pour un montant de deux milliards d’euros. Je ne pense pas que l’Allemagne se soucie beaucoup de savoir si l’armée allemande disposera d’armes qui fonctionnent ou non, elle veut envoyer plus d’argent à Israël. » Ce ne sont là que deux de ses mensonges les plus flagrants. Une preuve supplémentaire du fait qu’intervenir à l’ONU sur ce sujet n’est pas nécessairement le signe d’une grande probité intellectuelle…
L’histoire contre la haine
Ce mélange des genres a pris au dépourvu dès le départ certains intervenants, qui ne savaient visiblement pas où ils avaient mis les pieds. Ainsi, sur le premier panel, Lorenzo Kamel, habitué des plateaux d’Al Jazeera, a fait un exposé honnête, prenant en compte, à égalité, les points de vue israélien et palestinien. Las, mis en cause par une personne dans le public, il a dû défendre, avec le soutien d’une autre panéliste, Rina Cohen Muller, le travail de l’historien face aux idéologues :
« Quand je parle de nuances, ce n’est pas pour éviter de prendre position, mais en tant qu’historien, ma façon de prendre position n’est pas celle d’un politicien […]. Elle consiste à mettre en avant les cicatrices de l’histoire. […] Peu m’importe que vous soyez Israélien, Palestinien, musulman, chrétien, cela m’est complètement égal. […] Ma façon de voir les nuances est donc la suivante : ne pas considérer cela en termes d’ethnicité, de religion, etc. mais en termes de principes. »
Et de conclure :
« Comme je l’ai souvent mentionné au cours des deux dernières années, l’antisémitisme et l’anti-palestinisme sont les deux faces d’une même médaille. Tous deux sont enracinés dans une haine profonde envers les autres, et tous deux sont enracinés dans une ignorance profonde à l’égard des autres. Les personnes cohérentes, les universitaires cohérents, prennent tout en considération et rejettent les deux avec la même force. »
Des paroles sages mais, il faut bien le dire, plutôt isolées dans une charge d’ensemble contre Israël.
(À suivre)
>> Lire la deuxième partie : « Liberté académique » : à la recherche du 7-Octobre (2/4)
>> Lire la troisième partie : « Liberté académique » : inverser la Nakba (3/4)
>> Lire la quatrième partie : « Liberté académique » : l’idéologie contre la recherche (4/4)