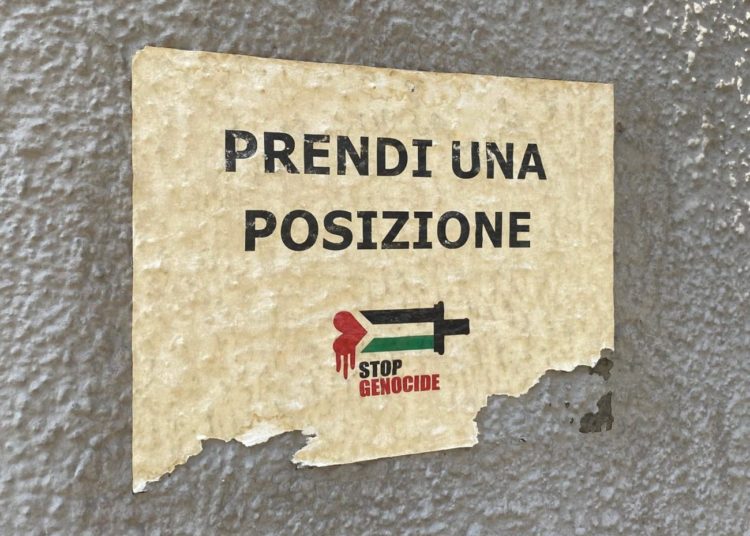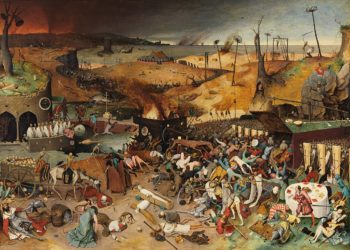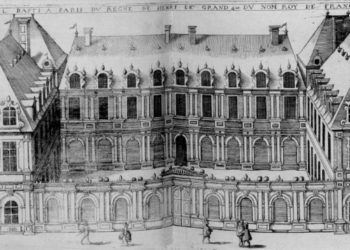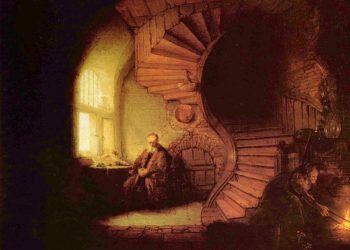Stéphanie Courouble-Share, docteure en histoire contemporaine, ISGAP (New-York) / LCSCA (Londres) / Comper Center (Haïfa)
Depuis plusieurs jours, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les territoires palestiniens occupés, multiplie les interventions publiques à Paris. Invitée de France Culture le 18 novembre 2025, elle déclarait encore : « Je ne suis pas une voix pro-palestinienne, je suis pro-droits humains. » Une profession de foi devenue son marqueur rhétorique, censée désamorcer les critiques adressées à ses prises de position.
Mais derrière cette formule soignée, son passage parisien met en lumière une proximité constante avec les réseaux antisionistes les plus radicaux, et un cadre idéologique qui s’éloigne nettement de la neutralité attendue de son mandat onusien.
Cette séquence s’inscrit d’ailleurs dans une continuité déjà analysée dans un article publié par Daniel Szeftel dans Le Droit de Vivre, « Du “colonialisme de peuplement” au “génocide” : sur les obsessions antisionistes de Francesca Albanese », où étaient détaillés les glissements conceptuels qui structurent son discours.
Des choix politiques assumés
Parmi les étapes les plus significatives de son séjour figure sa visite à la librairie Résistances, un lieu central de l’écosystème antisioniste français. Structurellement liée à CAPJPO-EuroPalestine, fondée par Olivia Zémor en 2002, cette librairie est depuis vingt ans un carrefour où se croisent extrême gauche, extrême droite, conspirationnistes, et les militants les plus radicaux. On y a notamment vu défiler, lors du meeting EuroPalestine de 2004, Dieudonné M’Bala M’Bala et Alain Soral.
Au fil des années, Résistances a accueilli des intervenants emblématiques de cette galaxie idéologique : Shlomo Sand (en 2009 et 2013), dont les thèses contestant l’existence du peuple juif servent de référence à l’antisionisme militant ; John Bastardi-Daumont, avocat du négationniste Robert Faurisson, en 2009 ; ou encore Gilad Atzmon, invité en 2011, ex-musicien israélien devenu propagandiste radical, qui a renoncé à sa citoyenneté israélienne et multiplié les prises de position en soutien à Faurisson, normalisant ainsi le négationnisme sous couvert d’antisionisme « humaniste ».
Choisir ce lieu plutôt qu’une institution académique n’a rien d’anodin : il signale un ancrage politique clair.
Carlos Latuff : un décor qui n’est pas neutre
Derrière Albanese à la librairie Résistances apparaît un dessin de Carlos Latuff, caricaturiste brésilien dont l’imagerie dénonçant Israël reprend régulièrement des tropes antisémites. Latuff avait obtenu en 2006 le deuxième prix du Concours international de caricatures sur l’Holocauste organisé à Téhéran, événement centré sur la négation et la distorsion de la Shoah. Comme le montrent Joël et Dan Kotek dans Au nom de l’antisionisme, ses caricatures reprennent « sans aucun doute » l’iconographie judéophobe du « Juif tueur d’enfants », largement relayée sur des sites se revendiquant « progressistes ». La présence de son dessin, daté de 2023, derrière Albanese s’inscrit donc dans un imaginaire politique bien identifié. On y voit la barrière de protection israélienne, sur laquelle est écrit le mot « Apartheid », démolie par un poing de couleur verte. Un « wow » de surprise s’échappe d’un mirador. Sur ce même mur, près du dessin, Albanese laisse une dédicace : « La liberté de tous et toutes avant tout. (Et entre la mer et la rivière) ».
France Culture : un moment de vérité
Lors de l’entretien sur France Culture, un échange éclaire particulièrement l’architecture idéologique de la rapporteuse. Le journaliste Guillaume Erner lui lance : « Mais j’espère que vous êtes sioniste, Francesca Albanese, non ? Puisque le sionisme est l’autodétermination du peuple juif. » Albanese n’hésite pas longtemps : « Euh… Non… Euh… je ne suis d’aucune idéologie. » Cette difficulté à reconnaître le droit du peuple juif à l’autodétermination, pourtant élémentaire dans le droit international, dévoile la cohérence de son positionnement : elle reprend sans distance critique les catégories du militantisme antisioniste. Dans la suite de l’entretien, elle adopte les catégories désormais devenues des incontournables du discours militant : symétrisation entre otages israéliens et prisonniers palestiniens, description d’Israël comme un régime d’apartheid, qualification de Gaza comme théâtre d’un « génocide ».
Ces termes, largement contestés dans la littérature académique, calquent exactement le lexique de CAPJPO-EuroPalestine, nourri par les références intellectuelles de Judith Butler et d’Ilan Pappé. Ils résonnent avec les lieux qu’elle fréquente et avec leurs réseaux militants.
Judith Butler, philosophe américaine influente, développe dans Parting Ways (2012) une critique du sionisme fondée sur un judaïsme diasporique et antinationaliste. Tout en récusant toute dimension antisémite, elle décrit certaines formes de sionisme comme un « colonialisme de peuplement », thèse aujourd’hui centrale dans l’antisionisme radical. Depuis le 7-Octobre, elle a franchi un seuil supplémentaire en affirmant que l’attaque du Hamas ne relevait ni du terrorisme ni de l’antisémitisme, mais d’une forme de « résistance armée », alignant ainsi explicitement son analyse sur une lecture postcoloniale justifiant la violence.
L’historien Ilan Pappé défend pour sa part, dans The Ethnic Cleansing of Palestine (2006), l’idée d’un plan prémédité d’expulsion des Palestiniens en 1948 et décrit le sionisme comme une idéologie coloniale. Depuis le 7-Octobre, il accentue sa radicalisation, notamment avec la publication en français, en 2025, de Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic, préfacé par Youssef Hindi, figure centrale d’Égalité & Réconciliation d’Alain Soral. Ce choix éditorial illustre les glissements opérés par certains intellectuels antisionistes vers des sphères conspirationnistes.
Quand le militantisme entre en collision avec un mandat onusien
Le problème n’est pas qu’Albanese défende la cause palestinienne. Beaucoup le font légitimement. Le problème est l’effacement constant de la frontière entre son mandat onusien et son activisme radical. Ses accusations répétées contre Israël, la minimisation de la violence du Hamas, ses références idéologiques univoques et ses fréquentations problématiques fragilisent la crédibilité d’un mécanisme censé incarner la neutralité internationale. Dans un contexte où l’accusation de « génocide » est devenue un instrument géopolitique, cette confusion affaiblit l’ensemble du système des rapporteurs spéciaux.
Prendre la parole dans un lieu associé à des figures négationnistes ou conspirationnistes — et le faire devant un dessin de Latuff — n’est pas un geste neutre. Cela légitime un écosystème idéologique qui fait glisser l’antisionisme politique vers une banalisation de tropes antisémites.