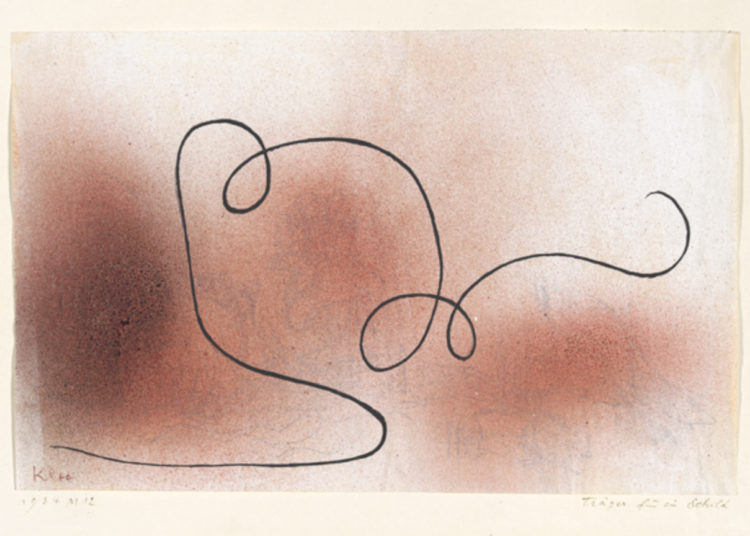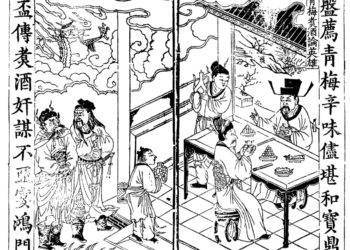Zhang Zhang, violoniste et entrepreneure sociale, fondatrice de ZhangOMusiq
Texte paru dans Le DDV n°695, été 2025
Il y a quelques années, j’ai eu le privilège d’assister à un symposium organisé par le neuroscientifique Stanislas Dehaene, spécialiste en psychologie cognitive et professeur au Collège de France. Ce fut l’occasion pour de nombreux neuroscientifiques de renom du monde entier de partager et de discuter de leurs recherches. Celles-ci, menées à Harvard, Columbia, au Massachusetts Institute of Technology (MIT) ou à Oxford, avaient une chose en commun : elles portaient sur la musique.
« Les arts des muses »
Ce fut une découverte extraordinaire. Depuis l’âge de deux ans, je joue de la musique mais je n’avais jamais réfléchi à ses « effets » sur mon cerveau, ni à ce que fait mon cerveau pour que je puisse jouer de la musique ! L’une des présentations les plus étonnantes, pour moi, de cette journée fut celle du professeur Nancy Kanwisher du MIT. La professeur Kanwisher et son équipe ont identifié dans le cerveau un territoire cortical dans la région temporale supérieure, dédié à la musique… à tous les styles de musique ! Cette région du cerveau est indifférente aux sons du langage parlé, de la nature et de l’environnement. Elle ne répond pas aux mélodies du chant des oiseaux ou à la rythmique de la pluie, mais spécifiquement à la musique créée par les êtres humains.
En clair, lorsque nous écoutons de la musique, qu’il s’agisse de l’opéra de Pékin, de bossa nova, de Mozart ou de Bob Marley, cette zone de notre cerveau s’éveille, s’illumine. Chaque être humain est né avec cette capacité, quelles que soient la couleur de nos peaux, de nos yeux, nos origines, nos cultures ou croyances. C’est l’une des caractéristiques singulières qui font de nous des êtres humains : nous somme une espèce musicale. Créer et apprécier la musique est l’instinct le plus naturel que nous ayons. Un fondement que tous les humains partagent, une preuve de notre commune parenté.
Dans la culture occidentale, le terme musique vient du grec ancien mousikê, « les arts des muses », juste éloge de l’une des plus sublimes expressions humaines. En langue chinoise, le terme « âme sœur » signifie littéralement « celui qui comprend ma musique ».
La diversité des langages musicaux des sociétés humaines est l’une des plus belles preuves de l’universalité de l’humanité, ainsi que la capacité d’écouter et de respecter les chansons des autres, tout en étant heureux de partager notre propre musique avec ceux qui ne l’ont jamais entendue, sans les obliger à l’aimer.
Transfiguration
En tant que musicienne, j’ai souvent été témoin de cette force puissante qui rapproche les êtres humains au-delà des barrières linguistiques et des différences culturelles. Elle est un pont qui nous relie, un bonheur qui nous rapproche, une grâce qui nous préserve. L’un des meilleurs exemples de l’immense pouvoir de la musique dont j’ai été témoin s’est produit pendant la pandémie de Covid-19, peu après le confinement, lorsque les déplacements locaux devinrent possibles mais que les voyages internationaux étaient encore déconseillés. J’ai rejoint mon amie la pianiste Elzbieta Ziomek Fringant pour nous produire régulièrement au centre de gérontologie Prince Rainier III de l’Hôpital Princesse-Grace de Monaco. Nos publics étaient des patients, souvent affaiblis par l’âge et des troubles cognitifs.
La toute première fois que je suis allé jouer dans une salle de patients en fauteuil roulant, j’étais un peu triste en les voyant. Ils semblaient tous perdus dans leur propre monde. La plupart étaient incapables de communiquer clairement ; ils n’étaient plus capables de comprendre ce qu’ils lisaient ou de regarder la télévision, leurs regards semblaient lointains, endormis ou confus.
Pourtant, lorsque la musique a commencé à résonner, en particulier les chansons qu’ils connaissaient, quelque chose de magnifique s’est produit, une transformation, voire une transfiguration. C’était comme s’ils se réveillaient soudainement. Leurs yeux embués commencèrent à briller ; leurs mains, souvent raides et inertes, commencèrent à battre en rythme. Le plus impressionnant était le chant : si certains avaient oublié la date de leur propre anniversaire, ils pouvaient se souvenir des mélodies des chansons qu’ils avaient aimées.
C’est un miracle permanent. Le cerveau, même s’il est affaibli et amoindri par le temps ou la maladie, peut se remémorer la musique que nous avons aimée par le passé. Est-il possible que la mémoire de la musique ne nous abandonne jamais, qu’elle nous accompagne fidèlement jusqu’à la fin du temps ?
Un bannissement contre-nature
Ainsi, tout système, civique ou religieux, qui empêche les êtres humains de vivre avec la musique, n’est pas seulement contre notre liberté, mais aussi contre notre nature. Si la censure de la musique n’a pas manqué à travers les âges, avec le bannissement de certains compositeurs ou styles de musique, la diffamation et la désinformation à leur sujet, dans le but de manipuler et de réprimer l’opinion, il est toutefois très rare qu’un régime, même parmi les plus cruels, ait complètement interdit la musique à l’échelle d’un État. Du moins avant le XXIe siècle.
En 2014, un garçon de 15 ans a été décapité publiquement par l’État islamique pour avoir écouté de la musique avec son baladeur CD. La même année, un imam a prêché devant un groupe de jeunes enfants, à Brest, l’interdiction de la musique, affirmant qu’elle venait du diable et que les personnes qui en écoutaient allaient se transformer en cochons ou en singes. En 2024, le gouvernement afghan a officiellement interdit aux femmes de chanter en public, après que les talibans ont procédé à la destruction des instruments de musique. En 2025, de nombreux « influenceurs » sur les réseaux sociaux prétendent que la musique est une source de corruption, un danger, un péché…
Créer et apprécier la musique est l’instinct le plus naturel que nous ayons. Un fondement que tous les humains partagent, une preuve de notre commune parenté.
La privation de la musique, dans la vie d’un être humain, est d’une cruauté inouïe. C’est aussi la caractéristique d’un système qui souhaite écraser et asservir l’esprit humain, en le privant de la beauté et de la connexion à sa propre force vitale.
« Le monde connaît la beauté parce que la laideur existe, nous apprécions la bonté parce que le mal nous est connu. » Lao Zi commence ainsi le deuxième chapitre du Daodejing. Peut-être que pour mieux connaître l’universalisme, il faut identifier ses adversaires.
Une petite lumière
Aujourd’hui, au sein même des démocraties libérales, si longtemps symboles d’espoir et d’émancipation, des menaces grandissent. Des imposteurs qui jouissent de tous les droits et de toutes les libertés choisissent le camp de la tyrannie au lieu de défendre les principes universalistes. Pis, ils le font en brandissant l’étendard du progrès, au nom de la justice sociale et de la diversité culturelle. Ces faussaires de la liberté servent en fait d’alibi à la barbarie et favorisent les divisions.
Il est facile de prôner l’intolérance quand son propre fils ne risque pas d’être exécuté pour avoir écouté du rock n’roll ; il est simple de prêcher le rigorisme moral quand ses propres filles ont toute liberté pour chanter le vent dans les cheveux… La barbarie est toujours plus acceptable quand ce sont les enfants des autres qui en sont les victimes.
La régression emprunte de nos jours le visage des luttes sociales : des militants qui se disent « antiracistes » ne défendent que ceux qui leur ressemblent ; des féministes qui se déclarent en guerre contre la misogynie monnaient leur solidarité selon l’origine des victimes et celle des agresseurs ; des élus qui préfèrent flatter leur électorat plutôt que promouvoir les valeurs universelles, et qui amplifient la peur et la haine, avec pour résultat d’alimenter la xénophobie qu’ils prétendent combattre…
Pourtant, malgré des positions apparemment irréconciliables, une petite lumière brille dans chacun de nos cerveaux à l’écoute de la musique. Si nous accordions plus de sens et d’importance à cette réalité physiologique, peut-être pourrait-elle contribuer à nous rapprocher et à nous unir.
L’idéogramme de Chine ancien pour désigner la musique est le même que celui qui sert à représenter la joie. Créer de la musique c’est créer de la joie. Jouons, écoutons et chantons plus. Que les puissants arts des muses soient avec nous !