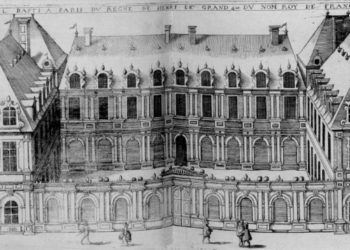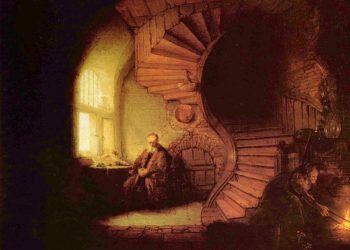Joël Kotek, historien, président de l’Institut Jonathas, Viviane Teitelbaum, sénatrice, secrétaire générale de l’Institut Jonathas
Raphaël Lemkin, qui forgea en 1942 le mot « génocide », entendait nommer « un crime sans nom » : la volonté planifiée d’effacer un peuple. Deux éléments cumulatifs s’imposent : l’intention spécifique de détruire comme tel un groupe national, ethnique, racial ou religieux (dolus specialis) et la décision organisée qui met cette intention à exécution. La jurisprudence internationale le répète : sans intention et sans dispositif d’extermination, on ne parle pas de génocide mais d’autres crimes — graves, parfois massifs — relevant d’autres qualifications. Qualifier la guerre de Gaza de « génocide » suppose de démontrer l’intention de détruire le peuple palestinien « comme tel » et une décision d’extermination traduite en plan, ordres, chaînes de commandement, organisation matérielle. Rien, ni dans la conduite des opérations israéliennes ni dans les énoncés publics des dirigeants, ne permet d’établir cette double condition. Les pertes civiles – tragiques, parfois insoutenables – n’équivalent pas à un projet d’anéantissement ; elles relèvent d’une guerre urbaine d’une violence extrême contre une organisation qui a intégré l’exposition de ses civils à sa stratégie.
Le sacrifice de « son peuple » par le Hamas
C’est pourquoi, à ce jour, la Cour pénale internationale ne retient pas la qualification de génocide. Ces évidences n’ont pas empêché le Hamas et à sa suite les opposants de toujours à Israël, de l’Université de Columbia à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), de faire du mot « génocide » une arme rhétorique de destruction massive.
Accuser l’État juif de génocide à Gaza n’est pas innocent : il plie le conflit israélo-palestinien à une dramaturgie où s’opère une inversion des rôles (les héritiers de la Shoah devenant à leur tour des génocidaires) qui satisfait en Occident une Schadenfreude (joie honteuse) à peine dissimulée. Mais qu’on se le dise, si le peuple gazaoui avait été réellement menacé d’extermination, à l’exemple des Arméniens ou encore des Tutsis, ses dirigeants auraient, dès la fin 2023, tout fait pour y mettre fin. Or, le Hamas a choisi de tergiverser. Comme l’a souligné la prix Nobel Herta Müller à propos du réseau de tunnels (environ 500 km) : « En Iran, on dit : “Israël a besoin de ses armes pour protéger son peuple. Et le Hamas a besoin de son peuple pour protéger ses armes.” » En refusant jusqu’à l’extrême limite de libérer les otages et en multipliant les faux-semblants diplomatiques, ses dirigeants ont sciemment prolongé une guerre dont ils escomptaient les dividendes politiques et symboliques.
La jurisprudence internationale le répète : sans intention et sans dispositif d’extermination, on ne parle pas de génocide mais d’autres crimes — graves, parfois massifs — relevant d’autres qualifications.
Convenons-en, aucun génocide avéré n’a jamais dépendu du bon vouloir des victimes pour cesser. Aucun ! Imagine-t-on un seul instant les dirigeants hereros, arméniens ou encore tutsi hésiter s’il leur avait été possible d’arrêter la machine de mort ? Poser la question, c’est y répondre.
L’histoire offre un contrepoint éclairant. À Vilna (Vilnius), en 1943, l’Organisation unifiée des partisans juifs – Yitzhak Wittenberg (communiste), Josef Glazman (sioniste révisionniste de droite), Abba Kovner (sioniste marxiste Hashomer Hatzair) – se fixe pour objectifs l’autodéfense du ghetto, le sabotage de l’effort nazi et la jonction avec l’Armée rouge. Quand les nazis exigent du conseil juif (judenrat) la remise de Wittenberg, celui-ci, face à la menace de liquidation du ghetto et au souhait d’une partie des habitants d’éviter des représailles de masse, choisit de se livrer aux nazis pour épargner les civils ; il mourra le jour même. Son sacrifice n’empêche pas la disparition du ghetto, tel est le propre du génocide ; une fois la décision d’anéantissement prise et la machine d’État lancée, aucune chance n’est laissée aux victimes : 95% des Juifs de la Jérusalem de l’Est furent assassinés. De ses 98 synagogues, il n’en reste qu’une.
Ce contraste éclaire le présent : là où la résistance juive calibra l’action armée à l’aune du coût humain civil, jusqu’au vain sacrifice de son chef, le Hamas fait de l’exposition des innocents une ressource opérationnelle et narrative, mettant en scène la souffrance civile comme levier diplomatique.
Évidemment, le fait qu’Israël ne commette pas de génocide n’exonère pas ses éventuelles responsabilités. Faut-il le rappeler ? La création d’un État palestinien aux côtés d’Israël relève de l’évidence ; que le Hamas doive en être exclu l’est tout autant. Mouvement idéologique clérical-fasciste, hostile non seulement aux Juifs mais aussi aux laïcs, aux femmes et aux minorités sexuelles, il ne peut incarner l’avenir d’un peuple qui mérite mieux que des extrémistes réclamant, depuis Doha, le sacrifice des siens au service d’une idéologie délétère.
Aveuglement pleinement assumé
La plupart de nos compatriotes n’ont que faire de cette triste réalité. Notre Belgique « vertueuse » n’a d’yeux que pour la Palestine, rien que la Palestine, toute la Palestine « du fleuve à la mer », débarrassée de cet État décidément trop juif. L’idée qu’Israël commet un génocide s’énonce comme une évidence. Et tous ceux qui s’essayent à nier cette (fausse) évidence risquent d’être tout simplement cancellés, voire menacés de sanction comme c’est le cas à l’université de Gand.
Comme dans le cas des Juifs (accusés hier d’avoir tué Jésus), la culpabilité des Israéliens ne fait aucun doute. Israël, dans les deux sens du terme, générique et particulier, est ontologiquement coupable et a contrario la Palestine ontologiquement innocente. Comment comprendre sinon que Rima Hassan qui, d’un côté se réjouit des exécutions publiques du Hamas post cessez-le-feu et, de l’autre, accuse les Israéliens de prélever et vendre depuis trente ans (sic) les organes vitaux des Palestiniens (resucée de l’accusation de crime rituel), se retrouve marraine de la dernière promotion de droit de l’ULB ? Charlie Hebdo ne s’y est pas trompé : hier Badinter, aujourd’hui Rima Hassan, demain Faurisson ?
Comment comprendre encore le tapis rouge déroulé dans cette même ULB pour cette Francesca Albanese dont les obsessions antisémites ont été documentées ? Pire encore, trois des plus prestigieuse universités de Flandre (Anvers, Bruxelles, Gand) devraient lui décerner un diplôme de Docteur honoris causa, preuve s’il en était de cet antisémitisme de culpabilité qui gangrène le pays flamand. La Shoah emporta 67% des Juifs d’Anvers dans un contexte d’intense collaboration.
On rêverait d’un zèle comparable pour le Soudan, où les massacres à froid de civils rappellent ceux du Rwanda.
Comment enfin comprendre que le PS et la FGTB (équivalent de la CGT) ont consacré leur dernier créneau concédé sur la RTBF à la seule question palestinienne ? On rêverait d’un zèle comparable pour le Soudan, où les massacres à froid de civils rappellent ceux du Rwanda. Mais comme ils sont le fait de milices arabes et islamistes, il n’est évidemment pas question de les soupçonner de racisme ou de visées génocidaires ; la RTBF se contente de parler de « possibles crimes de guerre ». Selon l’adage amer : « No Jews, no news. » Ainsi, 300 000 Africains : « possibles crimes de guerre » ; 65 000 Palestiniens, miliciens et civils confondus : « génocide », sans hésitation.
Pourquoi l’ « héroïque » Alexis De Swaef qui, grève de la faim à l’appui, survécut à quatre jours « de camp de concentration » israélien (sic) n’organise-t-il pas une caravane de véhicules terrestres pour documenter le calvaire des Darfouri non-arabes ? Trop dangereux, me direz-vous ? Certes.
« Fragilité blanche » et panique morale
Soyons sérieux, comment expliquer cette ferveur propalestinienne qui déborde la Belgique et traverse tout l’échiquier – de l’extrême-droite à l’extrême-gauche, via l’ « extrême-centre » catholique et ce, alors même que d’autres tragédies (Congo, Chine, Russie, Syrie, Soudan, Yémen) ne mobilisent presque personne ? Que la cause palestinienne soit légitime ne fait pas débat ; c’est l’intensité quasi-mystique qu’elle suscite qui interroge, notamment lorsque des cercles se revendiquant laïcs, progressistes, féministes ou LGBTQ+ s’alignent sur un mouvement clérico-fasciste qui bâillonne ou exécute ses propres « déviants » politiques et sexuels.
Laissons de côté le 7-Octobre, le féminicide et les viols systématiques commis contre des femmes israéliennes, trop souvent niés, minimisés, voire honteusement justifiés : le renversement moral est manifeste. À nos yeux, une seule explication tient la route : le rejet des Juifs qui structure depuis des siècles tant la psyché chrétienne que musulmane. Oui, Il existe une « fragilité blanche » à l’égard des Juifs – tour à tour perçus comme tueurs de Dieu (christianisme) ou de prophète (islam) – qui les expose encore au statut d’objets légitimes de haine. À l’évidence, les Juifs se retrouvent, une fois encore, au cœur d’une panique morale déferlante.
D’objet de critique politique, l’État juif est érigé en principe du « mal ».
Ce concept forgé par Stanley Cohen, systématisé par Erich Goode et Nachman Ben-Yehuda, désigne une peur collective disproportionnée et, plus largement, le mécanisme par lequel une société fabrique un danger symbolique pour réaffirmer son ordre moral. L’histoire offre des prototypes : persécutions antijuives médiévales, chasses aux sorcières, maccarthysme. Depuis le 7-Octobre, cette grille éclaire la bascule : d’objet de critique politique, l’État juif est érigé en principe du « mal ». Nos médias surjouent l’indignation (voir le dernier rapport de l’Institut Jonathas sur le traitement du 7 octobre dans la presse belge) ; nos « entrepreneurs de morale » attisent la colère et poussent au passage à l’acte ; nos responsables politiques diabolisent la cible jusqu’à produire un consensus répressif. Bref, le débat cède la place à l’essentialisation : « raciste », « nazi », « colonial pur », « génocidaire », « négationniste ». Un lexique de mots-totems qui n’informe plus mais qui excommunie et suggère qu’il faut en finir avec cet État décidément de trop.
À l’université, dans la culture, au parlement, l’hostilité devient un rituel de pureté civique. On ne discute plus des faits, on exige des allégeances. Beaucoup de Juifs se taisent ; d’autres, saisis par la peur ou par conformisme, se plient à la religion du moment. Ainsi configuré, l’antisionisme remplit la fonction décrite par Ben-Yehuda : donner l’illusion d’une cohésion retrouvée par la désignation d’un coupable symbolique et la promesse d’une purification par sa disparition.
Rien de tout cela ne réduit pourtant l’antisémitisme à une simple panique. Si des crises paroxystiques en dessinent les crêtes, l’antisémitisme demeure d’abord une idéologie — une constellation de croyances et de réflexes. Les paniques en sont l’écume ; la houle de fond reste l’antisémitisme structurel.