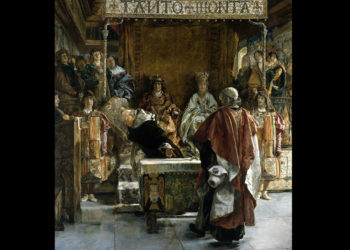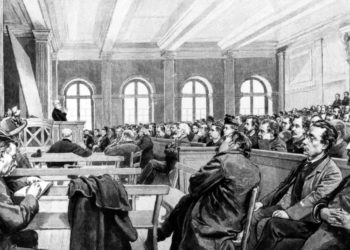Ornella Guyet, journaliste
>> Lire la partie précédente : « Liberté académique » : un colloque et des militants (1/4)
Au cours des deux journées d’échanges, qui se sont finalement tenues dans les locaux du Carep, le 7-Octobre a été, à de très rares exceptions près, occulté1L’intégralité des débats est accessible sur la chaîne YouTube du Carep : journée du 13 novembre / journée du 14 novembre 2025.. Ou, plus exactement, son caractère criminel a été tu. Le massacre a été présenté au mieux comme une réponse légitime à « l’occupation » et à « l’apartheid » israéliens, au pire, comme une attaque israélienne contre Gaza. Exception notable, Dominique de Villepin s’est vu contraint de condamner, au grand dam d’une Francesca Albanese grimaçante, cette attaque terroriste en des termes forts, à la suite d’une intervention depuis le public d’Abdel Razzaq Takriti (panel 2). Ce dernier avait en effet dressé un parallèle entre la « résistance » palestinienne et la « résistance » française.
Muriel Asseburg (panel 3) aurait pu pour sa part évoquer le 7-Octobre dans son intervention. La chercheuse allemande n’a-t-elle pas consacré un chapitre entier aux crimes commis ce jour-là dans son livre Der 7. Oktober und der Krieg in Gaza ? Les termes « massacre » et « acte de terreur » y apparaissent bien. Si elle n’oublie pas d’y mentionner les origines fréristes du Hamas, on peut lui trouver un ton parfois complaisant avec l’organisation terroriste. Celui-ci lui vaut de passer en Allemagne pour une pro-Hamas. En France, dans cet aréopage militant, elle passerait plutôt pour une « sioniste » indécrottable
Universitaire danois et militant d’extrême gauche, Sune Haugbølle intervenait quant à lui pour évoquer « l’émergence de la Palestine comme cause globale et ses échos contemporains » (panel 5). Haugbølle a lui aussi condamné le 7-Octobre dans son pays, même si cela faisait suite à une polémique l’opposant au quotidien conservateur Jyllands Posten et même s’il a admis, pendant le colloque, avoir lié des amitiés avec des militants du Front populaire de Libération de la Palestine (FPLP) réfugiés à Copenhague.
Difficile, donc, de parler d’une pluralité de sensibilités au sujet du 7-Octobre. Dans un essai paru en 2025, Gilbert Achcar, professeur émérite à l’École des études orientales et africaines de l’Université de Londres (panel 5), a expliqué que le 7-Octobre avait été une « contre-offensive »2Gilbert Achcar, The Gaza catastrophe. The Genocide in World-Historical Perspective, Sagi Books, 2025.. Thomas Vescovi (panel 7), juge quant à lui scandaleux qu’Israël ait diffusé « un film de quarante-cinq minutes cumulant les pires images du 7-Octobre » pour servir sa « propagande ». Tous deux expriment une opinion partagée par Álvaro Oleart (panel 5), chercheur post-doctoral à l’Université libre de Bruxelles (ULB), selon laquelle il n’est pas juste d’assimiler cet événement à un « pogrom », à un « génocide » et encore moins à la « Shoah ». La raison en est que « la chronologie du conflit est toujours située soit sur l’Holocauste, qui est perçu comme un événement sans durée particulière, soit sur le 7 octobre. Tout le reste est en quelque sorte retiré de l’équation. » D’où l’importance de la contextualisation.
« Contextualiser »
On touche là au cœur du discours de la très grande majorité des intervenants. Le 7-Octobre doit être « contextualisé ». La démarche serait tout à fait louable si « contextualiser » ne signifiait pas en l’occurrence en faire peser toute la responsabilité sur les victimes, plutôt que sur les tueurs, dans une logique d’inversion accusatoire désormais bien rodée.
Isaías Barreñada Bajo (panel 4) est membre du comité scientifique du Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (Cearc), équivalent espagnol du Carep, qui a ouvert ses portes à Madrid en juillet dernier. Le contenu de ses articles à prétention scientifique laisse peu de place au doute quant à leur caractère militant, quand il n’est pas question de complotisme (ici et là). Pour le professeur de l’Université Complutense de Madrid, le 7-Octobre est uniquement « le début de la guerre d’Israël contre la Bande de Gaza ». Barreñada inverse les rôles et fait porter au seul État juif la responsabilité de la guerre. Rien, au fond, ne justifie la réaction d’Israël :
« En octobre 2023, une action surprise de grande envergure menée par la résistance palestinienne3Souligné par nous. contre des cibles militaires et civiles israéliennes a donné lieu à une riposte massive de la part d’Israël. Une véritable guerre totale contre la bande de Gaza a été déclenchée sous prétexte de libérer les otages capturés par la résistance palestinienne et d’éradiquer les organisations armées4Isaías Barreñada Bajo, « El continuum de la necroayuda en Palestina. Del ‘modelo de ayuda de Oslo’ a la masacre de Gaza », in Laurence Thieux, Isaías Barreñada Bajo (dir.) , La Cuestión palestina – Colonialismo, Nakba, ocpación y genocidio, Madrid, Dynkinson, 2024.. »
Celui qui prête à Israël la volonté exprimée par Goebbels, dans son discours du 18 février 1943, d’une « guerre totale » contre les Alliés, surenchérit :
« Pour une grande partie de la communauté internationale, il était évident qu’Israël profitait de la guerre pour porter un coup dissuasif au peuple palestinien et provoquer un nouveau nettoyage ethnique, en forçant le dépeuplement de la bande de Gaza, dans le cadre d’une pratique pouvant être qualifiée de génocide5Isaías Barreñada Bajo, « El continuum de la necroayuda en Palestina. Del ‘modelo de ayuda de Oslo’ a la masacre de Gaza », in Laurence Thieux, Isaías Barreñada Bajo (dir.) , La Cuestión palestina – Colonialismo, Nakba, ocpación y genocidio, Madrid, Dynkinson, 2024.. »
Barreñada déplore qu’il puisse exister une « délégitimation constante de la résistance palestinienne qualifiée de terrorisme ». Nazifiant allègrement Israël, il soutient volontiers l’idée que cet État « a instrumentalisé l’Holocauste » : « l’impunité d’Israël repose également sur le maintien d’un récit sur l’exceptionnalité de l’État d’Israël et sur le « péché originel » européen de l’Holocauste, qui exploite la culpabilité pour les crimes commis et l’antisémitisme européen6Isaías Barreñada Bajo, « Memoria y presente de la destrucción de Palestina. De la Nakba de 1948 a la Nakba de Gaza », in Laurence Thieux, Isaías Barreñada Bajo (dir.) , La Cuestión palestina – Colonialismo, Nakba, ocpación y genocidio, Madrid, Dynkinson, 2024.. ». » Barreñada surveille toutefois son discours pendant le colloque, évitant les propos par trop polémiques.
Toujours en ce qui concerne le 7-Octobre, Andrea Teti, professeur associé de sciences politiques à l’Université de Salerne (panel 8), renvoie pour sa part aux commentateurs politiques, aux universitaires qui expliquent que « c’est géopolitique, que le recours à la violence par Israël vise à assurer la sécurité et la stabilité dans son voisinage immédiat ». Des crimes du Hamas, il n’est, là non plus, nullement question. Quant à Mandy Turner, « autrice indépendante » (panel 3), elle estime que le 7-Octobre trouve son orgine « dans la politique occidentale envers la Palestine et Israël » qu’elle qualifie de « consolidation de la paix contre-insurrectionnelle » :
« La raison structurelle à plus long terme de l’attaque du Hamas est le système d’apartheid colonialiste d’Israël, car les processus de dépossession et de violence provoquent toujours une opposition. […] La cause immédiate du 7 octobre était donc le cadre d’Oslo, élaboré à la suite des accords de paix de 1993 à 1995, et c’est là que mon cadre de consolidation de la paix en tant que contre-insurrection est utile. »
Et de conclure, car « l’Occident » doit être coupable :
« Si l’Occident n’avait pas sanctionné et isolé le gouvernement du Hamas, aurions-nous assisté à la guerre civile entre le Hamas et le Fatah et à la scission entre la Cisjordanie et Gaza ? Aurions-nous assisté au blocus israélien de la bande de Gaza ? Aurions-nous assisté aux événements du 7 octobre ? Je pense que nous aurions assisté à une situation très différente. »
Des propos cependant modérés en comparaison de ce qu’elle avance dans ses articles. Pour Turner, en effet, Israël « n’a aucun « droit à l’auto-défense » ni à la « sécurité ». » Quant à Hanna Al Taher (panel 7), elle considère que le 7-Octobre est un symbole « associé à la liberté ».
« Génocide » et « négationnisme »
À l’inverse, la thèse qu’un « génocide » a bien été commis à Gaza est largement considérée comme acquise par la majorité des intervenants. Intitulé « Anatomie d’un génocide », le « rapport » de Francesca Albanese sur le sujet, publié en mars 2024, sert de référence à chacun7Lire DanielSzeftel, « Du « colonialisme de peuplement » au « génocide ». Sur les obsessions antisionistes de Francesca Albanese », Le DDV, 17 novembre 2025.
Membre fondatrice du Cearc, Sonia Boulos a fait montre de modération durant le colloque. Elle s’est pourtant illustrée par la publication d’un article entier consacré à ce qu’elle appelle le « G-Word », c’est-à-dire le prétendu tabou entourant le mot « génocide », pour parler de la situation à Gaza8En référence au « N-word », substitué au mot « nigger » aux États-Unis, dans une optique politiquement correcte.. L’ensemble de cet article, d’une vingtaine de pages, vise à « analyser » les ressorts du « négationnisme » (« denialism ») qui vise ce « génocide », et en particulier celui provenant des « élites libérales » (au sens anglo-saxon du terme), en particulier israéliennes. Le ton est résolument militant :
« Je soutiens que ce mode libéral de négationnisme génocidaire remplit une fonction idéologique spécifique : empêcher toute possibilité de décolonisation transformatrice. En rompant le lien entre la violence génocidaire actuelle à Gaza et la violence fondatrice de la Nakba, le négationnisme libéral empêche tout effort visant à remédier à l’ensemble des injustices historiques et structurelles qui définissent le projet colonialiste en Palestine. Ce faisant, il présente le génocide comme une aberration plutôt que comme le résultat logique d’un ordre politique fondé sur la sécurité permanente de la population colonisatrice au détriment des autochtones. Ce cadre dépasse le débat strictement juridique sur le génocide, occultant la nature structurelle et durable de la violence coloniale. »
Sonia Boulos établit un lien direct entre colonisation et génocide, une thèse éminemment contestable (et contestée), qui a gagné en popularité au fil des derniers mois dans les milieux décoloniaux.
L’Europe complice
S’il y a « génocide », il y a forcément « complicité ». Le thème du colloque invitait à pointer l’Europe du doigt, trois invités au moins – Isaías Barreñada, Sonia Boulos et Dimitris Bouris – ne s’en sont pas privés. « L’inaction qu’elle soit intentionnelle ou liée aux procédures de décision, et même le silence qui en découle, constitue une forme de comportement complice », a expliqué le premier. « Ce que font les institutions européennes, c’est reconstruire le droit international de manière à permettre le génocide, à en faire une option légale », a renchérit la deuxième. Le troisième a développé :
« L’engagement plus large de l’UE à Gaza contribue à qualifier une impasse profondément politique de « question humanitaire ». Il ne s’agit pas d’un ouragan, mais d’un génocide en direct, ce n’est donc pas une question humanitaire, mais un génocide actif que nous avons tous vu sur nos écrans. Il n’y a aucune déclaration, annonce ou communiqué de l’UE qui soulève la question de la survie des Palestiniens sans la relier à celle des Israéliens. »
Le 14 novembre, dans sa prise de parole, Bouris considère en outre que le conditionnement de l’aide européenne à l’Autorité palestinienne au fait qu’elle cesse de rétribuer les terroristes palestiniens emprisonnés en Israël (qu’il nomme « les salaires des prisonniers ») porte atteinte à un « des piliers sacrés de la résistance à la domination coloniale par la grande majorité de la population indigène des territoires palestiniens occupés ».
Au cours de ces deux journées, la règle commune sembla de se garder de prendre en compte tout point de vue israélien. Il faut donc se résoudre à constater, une fois de plus, que ceux qui dénoncent à tout va un « effacement » des Palestiniens n’ont de cesse d’ignorer, dans leurs analyses, la réalité israélienne.
(À suivre)