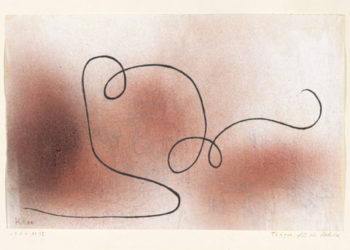Zhang Zhang, violoniste et entrepreneure sociale, fondatrice de ZhangOMusiq
« Tout ce qui est, sous le ciel, trop longtemps divisé, se réunira, trop longtemps uni, se divisera. » Telles sont les premières lignes du roman classique chinois Les Trois Royaumes (XIVe siècle) sur l’époque de la fin de la dynastie Han, au IIIe siècle, lorsque la Chine était divisée et que trois grands seigneurs de guerre cherchaient à dominer l’empire au nom du ciel, de la paix et pour le bénéfice de tous.
La dynastie Han a été l’une des plus grandes dynasties de l’histoire de la Chine. Son influence a été si grande que le peuple chinois porte encore aujourd’hui le nom de Han. Mais comme pour tous les grands empires, il arrive un moment de fragilité et de danger. L’année 184 fut ce moment. La puissante dynastie Han était dirigée par un empereur âgé de 9 ans, retenu en otage par l’ambitieux Cao Cao, qui voulait le trône du dragon pour lui-même. Mais d’autres voulaient la même chose. Chacun des grands seigneurs se considérait comme le gardien légitime de la nation ; chacun menait ses armées à la guerre au nom de la « voie du ciel », en tant qu’élu unique doté du mandat sacré, et considérait ses rivaux comme des rebelles, des parvenus et des ennemis de l’empire.
Outre ces trois forces principales, il existait de nombreux fiefs régionaux dirigés par des seigneurs de guerre ou des nobles locaux qui luttaient également pour l’expansion, l’influence et le pouvoir. Les alliances se faisaient et se défaisaient. Il y eut des batailles célèbres, des histoires de courage, de loyauté et de trahison. Les guerriers n’étaient pas les seuls à être célébrés ; les stratèges, sages et rusés, étaient les plus appréciés par tous les camps. Les services des meilleurs tacticiens étaient au moins aussi prisés que ceux des meilleurs guerriers. C’était l’époque de la bataille des armes et des esprits. Chaque faction déclarait que l’objectif était d’instaurer un empire uni, la paix et la prospérité sous le ciel. En réalité, il s’agissait d’une lutte pour le pouvoir entre les chefs les plus ambitieux qui rêvaient d’une domination totale.
Le ferment de destruction
Les récents développements politique en France font écho à cette époque lointaine de la terre de mes ancêtres, où, au nom du bien de la nation, certains élus se battaient les uns contre les autres pour établir leur domination. Si les armes ne sont pas utilisées, les stratagèmes n’en sont pas moins rusés et les intentions tout aussi agressives, visant non la mort physique mais la mort politique et sociale de l’adversaire. Quitte à plonger le pays dans l’instabilité et le chaos.
Quand les socialistes ne sont plus universalistes, quand l’insoumis est totalement soumis à l’ambition d’un seul homme, quand un « rassemblement national » ne rassemble pas mais divise, quand les dirigeants placent la gloire et l’ambition personnelle au-dessus de l’intérêt du peuple qu’ils prétendent vouloir guider et protéger, le résultat est toujours à l’opposé des promesses.
La période des Trois Royaumes a conduit à l’effondrement de Han, dynastie fondatrice de la civilisation chinoise, provoqué l’une des ères les plus sanglantes de l’histoire de la Chine. À la fin de cette période, la population totale est passée de près de 60 millions à moins de 20 millions d’âmes. En fin de compte, aucune des trois grandes forces n’a gagné. Après avoir épuisé leurs terres, leur peuple, et leurs talents, elles ont laissé le pays en ruines.
Avec l’éclatement de l’ancien empire Han, la période des Trois Royaumes a conduit à une fragmentation totale de l’empire qui a facilité l’invasion massive par des puissances étrangères, des ennemis historiques au-delà de la Grande Muraille, des tribus nomades cherchant à envahir et à dominer la Chine, qui, à l’époque précédente, avaient été repoussées au prix d’efforts constants et d’immenses sacrifices. Cette longue période de feu et de sang, de famine et de peur, s’est poursuivie pendant plusieurs siècles. La réunification s’est finalement produite quatre siècles plus tard, sous la brève dynastie des Sui, et s’est achevée sous les Tang au VIIe siècle.
Les remparts ne fonctionnent pas toujours, même ceux qui sont aussi gigantesques que la Grande Muraille, car, bien souvent, le ferment de destruction est à l’intérieur. On connaît la sentence célèbre de l’historien Arnold J. Toynbee selon lequel les civilisations meurent par suicide et non par meurtre. Est-il dans la nature de l’humanité de détruire ce qu’elle a construit avec amour et courage ? La paix et la prospérité durement acquises peuvent être rapidement anéanties.
Le monde du XXIe siècle montre des signes de fragmentation croissante. À l’heure où un véritable rassemblement national serait nécessaire pour préserver la paix et la prospérité, l’imposture d’individus égocentriques agissant au nom de bien universel constitue un risque réel pour tous.