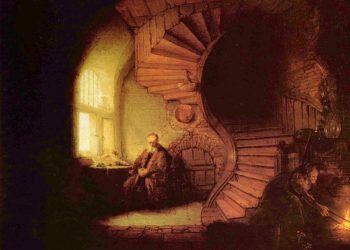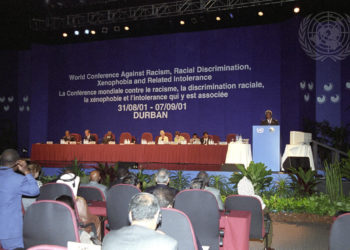Par Nathalie Heinich, sociologue, directrice de recherche au CNRS (EHESS)
(Entretien paru dans Le DDV n°683, juin 2021)
Il y a une vingtaine d’années l’on ne parlait guère d’identité dans le débat public, et il y a une quarantaine d’années le terme était quasiment absent des sciences sociales, du moins en France. Sa montée en puissance dans le vocabulaire politique remonte essentiellement aux premières années de notre siècle, avec le projet controversé d’un « ministère de l’Identité nationale » et d’un « musée de l’Identité nationale », sous la présidence de Nicolas Sarkozy – l’un et l’autre projets ayant été finalement abandonnés.
C’est donc sous une image « de droite » que la notion d’identité s’est invitée en France, associée à la défense d’une conception de ce qu’est ou doit être le pays face à ce que certains perçoivent comme une menace, en particulier, bien sûr, les effets de l’immigration. Mais elle n’a pas tardé à glisser dans le vocabulaire de la gauche dès lors qu’il s’est agi de défendre les droits « culturels » – et non plus seulement civiques, sociaux ou économiques – de collectifs considérés comme minoritaires, marginalisés ou infériorisés : c’est ainsi que « l’identité féminine », « l’identité homosexuelle », « l’identité noire », « l’identité musulmane » sont devenus des objets de revendication ou de « lutte pour la reconnaissance », selon une terminologie introduite dans les années 1990 par le philosophe allemand Axel Honneth1.
L’on voit ainsi que, dans ses usages politiques, la notion d’identité n’est constitutivement ni de droite ni de gauche : tout dépend de la façon dont elle est employée et, plus précisément, du collectif auquel elle fait référence. Pour peu que le collectif dont il s’agit de protéger « l’identité » soit référé à une instance majoritaire ou très générale (« la société » dans son ensemble, la République, la nation, la chrétienté…), alors la thématique identitaire se trouve stigmatisée, au moins par une partie de la gauche, comme l’expression des « dominants », et donc de droite sinon d’extrême droite. En revanche, pour peu que le collectif de référence soit considéré comme partiel ou infériorisé, l’identité devient un nouvel instrument protestataire pour la gauche.
Universalisme contre communautarisme
Mais la situation s’est encore complexifiée avec l’importation en France, via les campus américains, d’une systématisation des revendications centrées sur la défense des droits et des intérêts des « communautés » : populations autochtones aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, communauté noire, communauté hispanique, femmes, homosexuels… C’est ce que l’on nomme outre-Atlantique « identity politics » (politique « identitaire » voire « identitariste »), devenue un emblème de la gauche radicale, et qui commence à être fortement critiquée au sein même de la gauche par ceux qui y voient une menace communautariste de désagrégation du corps social, de repliement et de guerres intestines2, voire de perte d’une grande partie de l’électorat traditionnel de la gauche qui dès lors risque de glisser à droite3. L’on en voit les effets en France, surtout à partir des années 1990, avec l’importation à l’université des « études de genre », des « gay studies », des « études décoloniales » (centrées sur les discriminations raciales), etc., ainsi que, dans le milieu culturel, avec des tentatives pour interdire des productions artistiques considérées comme étant de l’« appropriation culturelle » (par exemple un spectacle théâtral mettant en scène des Amérindiens et joué par des acteurs blancs).
Dès lors le clivage politique qui fait éclater la notion d’identité ne porte plus tant sur l’opposition droite/gauche que sur l’opposition entre universalisme et communautarisme (parfois nommé aussi « différentialisme », notamment au sein du mouvement féministe). Les partisans de l’« universalisme républicain », qu’ils soient de gauche ou de droite, reprochent aux tenants de luttes centrées sur les identités collectives considérées comme « dominées » ou « discriminées » de porter atteinte au lien social en incitant au « séparatisme », d’essentialiser des traits culturels en y réduisant autoritairement leurs porteurs quels que soient les contextes, et en occultant derrière ces « identités » les problèmes d’inégalité sociale traités traditionnellement par la gauche. En face, les partisans d’une focalisation des luttes sur des identités communautaires entendent privilégier le respect de la « diversité », ou « l’intégration » plutôt que « l’assimilation » des immigrés au motif qu’il faut respecter leur « identité » ou leur « culture » d’origine, et reprochent aux universalistes de nier ou d’occulter la réalité des discriminations liées au sexe, à l’origine ethnique, à l’orientation sexuelle ou à la religion4.
L’on est donc passé en une dizaine d’années d’une identité « de droite » à une identité « de gauche », puis à un identitarisme propre à la gauche radicale – pour se contenter ici d’un tableau à grands traits. Voilà qui interdit toute interprétation consensuelle de l’appartenance idéologique de cette notion d’« identité ». À chacun donc d’employer ou pas cette notion selon sa sensibilité politique, en sachant toutefois les risques de malentendus qu’elle comporte étant donné sa polyvalence.
Ni réalité objective, ni illusion à démythifier
Mais il existe aussi un usage non plus politique mais scientifique de cette notion, qui a fait la preuve de son utilité dès lors qu’elle est convenablement définie – que ce soit par la psychologie sociale, la sociologie, l’anthropologie ou la philosophie. Ce travail de définition permet d’éviter un certain nombre de malentendus, qui se retrouvent tant dans des travaux universitaires que dans les usages naïfs, non conceptualisés, propres à l’utilisation politique de la notion d’identité.
Le principal de ces malentendus concerne le statut « ontologique » de l’identité : pour le sens commun elle serait une réalité objective, une essence, une entité existant en soi, tandis qu’à l’inverse, pour les sociologues « constructivistes » ou les philosophes « déconstructionnistes », elle ne serait qu’une « construction sociale », donc une « illusion »5, dont il faudrait se débarrasser. Mais ce sont là deux erreurs symétriques et inverses : ni réalité objective à laquelle se référer, ni illusion à démythifier, l’identité est une représentation mentale que l’on se fait de ce qu’est ou doit être un objet – qu’il s’agisse d’un sujet individuel ou d’un collectif, tel qu’un pays.
Ainsi conçue, l’identité n’est pas la cause mais plutôt le résultat de l’ensemble des opérations par lesquelles les sujets expriment et mettent en actes leurs représentations : en se percevant soi-même, en se présentant à autrui et en étant désigné par autrui comme étant ceci ou cela, l’on possède telle ou telle identité – qui peut varier bien sûr selon les contextes. Si les paramètres objectifs de l’identité ne sont pas forcément du ressort d’un choix individuel (on ne choisit pas sa nationalité de naissance ou sa couleur de peau), en revanche il existe une certaine marge de liberté dans la façon dont on se présente à autrui, et dans la façon dont on qualifie quelqu’un. Là se situe l’alternative entre une identité universaliste et une identité communautariste : la première consiste à se donner comme collectif de référence une entité à haut niveau de généralité, telle la nation, tandis que la seconde consiste à se référer à un collectif infra-national, susceptible d’opérer des divisions internes à la « communauté des citoyens »6.
C’est pourquoi le choix politique en matière d’identité, dans sa dimension civique, ne consiste pas à revendiquer ou à récuser la notion même d’identité, mais à la référer soit à une appartenance communautaire immédiatement lisible mais source de divisions (sexe, couleur, religion…), soit à cet idéal universaliste qu’est le partage d’une même citoyenneté.
[1] Axel Honneth, La Lutte pour la reconnaissance, 1992, Paris, Cerf, 2000.
[2] Laurent Dubreuil, La Dictature des identités, Paris, Gallimard, 2019.
[3] Mark Lilla, La Gauche identitaire. L’Amérique en miettes, Stock, 2017.
[4] Nathalie Heinich, Oser l’universalisme. Contre le communautarisme, Lormont, Le Bord de l’eau, 2021 (à paraître).
[5] Pierre Bourdieu, L’illusion biographique, Actes de la recherche en sciences sociales, n° 62-63, juin 1986.
[6] Dominique Schnapper, La Communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard, 1994.
>> Pour un développement des idées proposées dans cet article, on pourra se reporter au livre de Nathalie Heinich Ce que n’est pas l’identité (Gallimard, 2018).