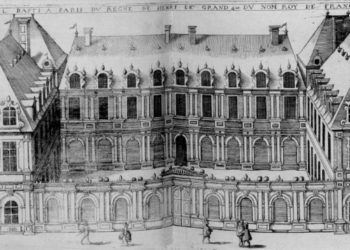Thomas Hochmann, professeur de droit public à l’université Paris Nanterre
Restée dans les mémoires pour avoir créée le délit de négationnisme, la loi du 13 juillet 1990 dite « Gayssot » ne se limitait pas à cette innovation. Tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, elle introduisait bien d’autres nouveautés, dont la possibilité de priver de leur éligibilité les individus condamnés pour provocation à la haine raciste.
Initialement, les députés entendaient permettre au juge de prononcer plus largement la privation des droits civiques prévue à l’article 131-26 du Code pénal. Le garde des Sceaux Pierre Arpaillange argumenta néanmoins avec succès pour limiter cette peine complémentaire à l’éligibilité (ainsi qu’au droit d’exercer une fonction juridictionnelle). Le droit de vote ne saurait être retiré à ces « esprits faux et égarés », afin de ne pas les « exclure de la communauté nationale ». Il convenait plutôt de « leur apprendre la tolérance, le respect d’autrui et la démocratie ». Depuis 1990, l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit donc que les personnes condamnées pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence racistes peuvent être privées d’éligibilité pour une période de cinq ans au plus.
Une telle mesure est-elle conforme à la garantie de la liberté d’expression ? Pourquoi n’est-elle presque jamais utilisée ? Devrait-elle l’être davantage ?
Une inéligibilité conforme à la liberté d’expression
La possibilité d’une inéligibilité temporaire constitue-t-elle une atteinte excessive à la liberté d’expression ? Le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur la disposition contenue à l’article 24 de la loi de 1881. En 2016, la Cour de cassation a refusé de lui renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité sur le sujet, au motif que le grief allégué était dénué de caractère sérieux1. Pour la Cour, une telle peine, « prononcée par le juge en tenant compte des circonstances propres à l’espèce », n’était pas disproportionnée.
Du côté de la Cour européenne des droits de l’homme, l’inéligibilité du raciste ne semble pas non plus poser de difficulté. En 2009, la Cour s’est accommodée de la condamnation du président du Front national belge2. Ses tracts appelant à rapatrier les immigrés, à s’opposer à « l’islamisation de la Belgique » ou à « interrompre la politique de pseudo-intégration » lui avaient valu une peine composée de 250 heures de travail dans le secteur de l’intégration des personnes étrangères ainsi que d’une privation pendant dix ans de son éligibilité. La Cour européenne des droits de l’homme rappela, comme elle le fait souvent, qu’« il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale », et jugea que la peine n’était pas disproportionnée. Si elle laissa transparaître une inquiétude sur la longueur de l’inéligibilité, elle ne remit nullement en cause son principe.
Dans une série d’affaires plus ancienne, la Commission européenne des droits de l’homme avait pour sa part accepté l’inéligibilité perpétuelle d’anciens collaborateurs ou d’anciens SS qui souhaitaient, des années après la fin de la guerre, se présenter aux élections3. Dans la décision la plus marquante, la Commission considéra que deux dirigeants d’une organisation raciste ne pouvaient se prévaloir de la Convention européenne des droits de l’homme pour obtenir le droit de se présenter à des élections qu’ils souhaitent remporter afin de détruire les droits qu’elle garantit et les valeurs qu’elle promeut4.
La possibilité offerte au juge français de prononcer l’inéligibilité, pour cinq ans au plus, d’une personne condamnée pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence racistes ne paraît donc pas poser de problème du point de vue du droit européen des droits de l’homme ni, à en croire la Cour de cassation, eu égard à la Constitution. Pourquoi, dès lors, cette peine n’est-elle presque jamais prononcée ?
Une sanction inutilisée par addition de réticences
L’inéligibilité temporaire du raciste n’est guère ordonnée par les juges. Un des rares cas concernait un maire du Var, qui avait accusé les Roms présents dans sa commune d’être à l’origine d’incendies, y compris de leurs propres caravanes. Il est « presque dommage », ajoutait-il, que l’on ait appelé les secours trop tôt. Il fut condamné à 10 000 euros d’amende et à un an d’inéligibilité. Un autre cas portait sur une candidate du Front national qui avait comparé Christiane Taubira à un singe5. Le jugement, ultérieurement annulé pour une raison de procédure, la condamnait pour injure raciste et provocation à la haine à une peine de prison ferme et à cinq années d’inéligibilité. Dans l’immense majorité des cas, cependant, la condamnation d’une provocation à la haine raciste n’est pas accompagnée d’une privation du droit de se présenter à une élection. Comment l’expliquer ?
Une première raison tient sans doute à ce que l’inéligibilité paraît dénuée de sens à l’égard d’une personne qui n’est ni élue, ni candidate à une élection ou au moins membre actif d’un parti politique. Pourquoi interdire à quelqu’un de se présenter à une élection alors qu’il n’en a visiblement nullement l’intention ?
Une deuxième raison s’attache peut-être au malaise qu’éprouvent les juges à édicter une sanction à l’apparence antidémocratique, qui leur paraît beaucoup plus lourde que les peines d’amendes qu’ils prononcent quotidiennement. En 2017, le législateur avait souhaité leur faciliter la tâche. La loi sur la confiance dans la vie politique introduisait une peine obligatoire d’inéligibilité temporaire pour les personnes reconnues coupables d’un certain nombre d’infractions, telles que des agressions sexuelles ou des fraudes fiscales. Durant les travaux parlementaires, un amendement reprenant notamment certaines préconisations de la Licra ajouta à la liste les délits d’expressions racistes.
L’article 132-21 du Code pénal prévoit cependant que « l’interdiction de tout ou partie des droits civiques […] ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale ». De plus, depuis plusieurs années, le Conseil constitutionnel est très hostile aux peines « automatiques » d’inéligibilité, qui lui paraissent contraire au principe d’individualisation des peines, en vertu duquel une sanction ne peut être « appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce »6. N’ignorant pas cette difficulté, le Parlement avait précisé que le juge pouvait décider de ne pas prononcer l’inéligibilité, « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». La nouvelle peine « obligatoire » d’inéligibilité ne l’était que par le nom. Mais l’inéligibilité cessait malgré tout d’être une conséquence exceptionnelle des condamnations pour racisme. Elle devenait la règle, que le juge ne pouvait écarter qu’à l’appui d’une décision spécialement motivée.
Saisi par soixante députés, le Conseil constitutionnel jugea que ce système n’était pas contraire à l’individualisation des peines, dès lors que l’inéligibilité devait malgré tout être expressément prononcée par le juge, à qui il revenait d’en fixer la durée voire de l’écarter le cas échéant. Néanmoins, alors même que la saisine parlementaire ne soulevait nullement ce point, le Conseil constitutionnel décida de se saisir d’office du cas particulier des expressions racistes. Il jugea inconstitutionnelle l’inéligibilité « obligatoire » des personnes condamnées pour de tels propos, à l’appui d’une motivation indigente (et grammaticalement douteuse) qui tient en quatre lignes : « La liberté d’expression revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales. Dès lors, pour condamnables que soient les abus dans [sic] la liberté d’expression visés par ces dispositions, en prévoyant l’inéligibilité obligatoire de leur auteur, le législateur a porté à la liberté d’expression une atteinte disproportionnée7. » Les juges ne conservent donc à leur disposition que le mécanisme issu de la loi Gayssot, qui leur impose de prendre à leur compte le choix de prononcer l’inéligibilité.
Une troisième raison qui explique leur réticence à le faire est liée à la formulation maladroite de la loi. En 1990, le gouvernement souhaitait assurer que l’inéligibilité frappe le raciste et seulement lui. En effet, en vertu de la loi de 1881, les premiers responsables des délits de presse sont les directeurs de la publication où ont paru les propos condamnables. Une exception à la possibilité de prononcer l’inéligibilité fut donc introduite dans la loi à leur intention. Jacques Toubon, alors député de l’opposition, insista pour que cette exception touche aussi les journalistes. Un rapide dialogue en séance publique scella l’affaire. Les protagonistes raisonnèrent à partir du cas de propos racistes rapportés par un journaliste dans une publication. Aucun d’eux ne s’aperçut qu’en excluant « l’auteur » de l’expression poursuivie (dans leur esprit : le journaliste), ils compliquaient grandement l’objectif poursuivi, à savoir l’inéligibilité du raciste, qu’il paraît difficile de ne pas concevoir comme « l’auteur » des propos lorsque ceux-ci ne subissent aucune médiation et sont directement tenus, par exemple à la radio ou à la télévision.
Cette difficulté n’est cependant pas dirimante, elle n’annule pas la possibilité d’une inéligibilité. Les juges savent, lorsqu’ils le souhaitent, faire preuve d’imagination. Il leur est par exemple possible d’écarter une interprétation qui priverait presque la loi de tout effet, pour retenir une conception étroite de « l’auteur », qui corresponde à ce qu’indiquent les travaux parlementaires. Bien des solutions existent pour les juges qui entendent prononcer la peine voulue par le législateur de 1990. Reste à savoir s’il s’agit là d’un objectif souhaitable.
Une mesure protectrice de la démocratie à revivifier
L’inéligibilité temporaire des personnes condamnées pour racisme paraît toute indiquée. D’abord, comme le remarquait le rapporteur de la loi Gayssot à l’Assemblée nationale, François Asensi, cette mesure est bien plus adaptée que l’amende ou la prison pour frapper « celles et ceux qui veulent faire commerce des thèmes racistes afin de prospérer électoralement ».
Ensuite, elle s’inscrit parfaitement dans un système de « démocratie militante » ou, comme le disent les Allemands, de démocratie « combative » ou « apte à se défendre » (streitbare ou wehrhafte Demokratie). Un tel régime refuse de laisser les adversaires de la démocratie libérale profiter des moyens qu’elle offre afin de parvenir au pouvoir pour la détruire. Pour ce faire, la démocratie a recours à des outils anti-démocratiques, l’exemple type étant la dissolution des partis politiques qui lui sont hostiles. Un régime plus ouvert laisse les racistes participer aux élections. Il revient alors aux électeurs de les écarter du pouvoir. Si la majorité souhaite au contraire les élire, alors la démocratie disparaît en étant restée fidèle à elle-même.
Tel n’est pas, cependant, le régime en vigueur en France, où les propos racistes sont interdits. Il est contradictoire de permettre aux personnes récemment condamnées pour de tels délits de concourir aux élections. Pour que les racistes soient éligibles, il faut d’abord dépénaliser l’expression raciste, comme c’est le cas aux États-Unis. Dans l’arrêt précité relatif au président du Front national belge, une opinion dissidente rédigée par le juge hongrois Andras Sajó, très séduit par le régime américain de la liberté d’expression, critiquait l’inéligibilité du requérant mais aussi la condamnation de ses propos. L’éligibilité des racistes s’accompagne de la libération de leurs propos, tandis que leur interdiction doit entraîner l’inéligibilité. La cohérence est à ce prix.
Il n’en demeure pas moins qu’une telle décision est extrêmement délicate à prendre à l’approche d’une élection. C’est plus tôt qu’il faut intervenir, avant même que le raciste n’ait fait montre de la moindre velléité électorale. Si l’élection approche, si les sondages sont bons, une éventuelle condamnation assortie d’une inéligibilité vaudra bien des attaques envers le juge qui la prononcera, quand bien même elle serait parfaitement fondée juridiquement.
Il n’est en revanche pas rare que le Parlement réagisse à l’actualité, et l’effrayant spectacle que nous offre actuellement la précampagne électorale pourrait constituer l’occasion de modifier le droit applicable. Le Parlement prendra garde à ne pas conférer une apparence d’automaticité à l’inéligibilité, afin d’éviter la censure du Conseil constitutionnel. Il convient en revanche de réparer la mauvaise rédaction de 1990, afin d’ôter tout doute sur l’applicabilité de cette mesure, y compris pour des propos tenus à la télévision. Peut-être aussi faut-il songer à ne pas réserver l’inéligibilité aux personnes condamnées pour provocation à la haine raciste, mais l’étendre aux cas d’injures et de diffamations racistes, qui disqualifient tout autant à l’exercice des responsabilités publiques. Si le triste épisode Zemmour sert à cela, il n’aura pas eu que des effets délétères.
Notes :
[1] Cass. crim., 30 mars 2016, 15-84.511.
[2] Féret c. Belgique, 16 juillet 2009.
[3] X. c. Pays-Bas, 19 décembre 1974 ; X. c. Belgique, 3 décembre 1979 ; Van Wambeke c. Belgique, 12 avril 1991.
[4] Glimmerveen et Hagenbeek c. Pays-Bas, 11 octobre 1979.
[5] Voir Gwénaële Calvès, Envoyer les racistes en prison ? Le procès des insulteurs de Christiane Taubira, LGDJ, 2015.
[6] Voir par exemple la décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015 (peine complémentaire obligatoire de fermeture d’un débit de boisson).
[7] Décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.