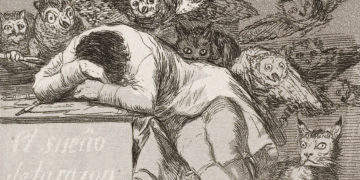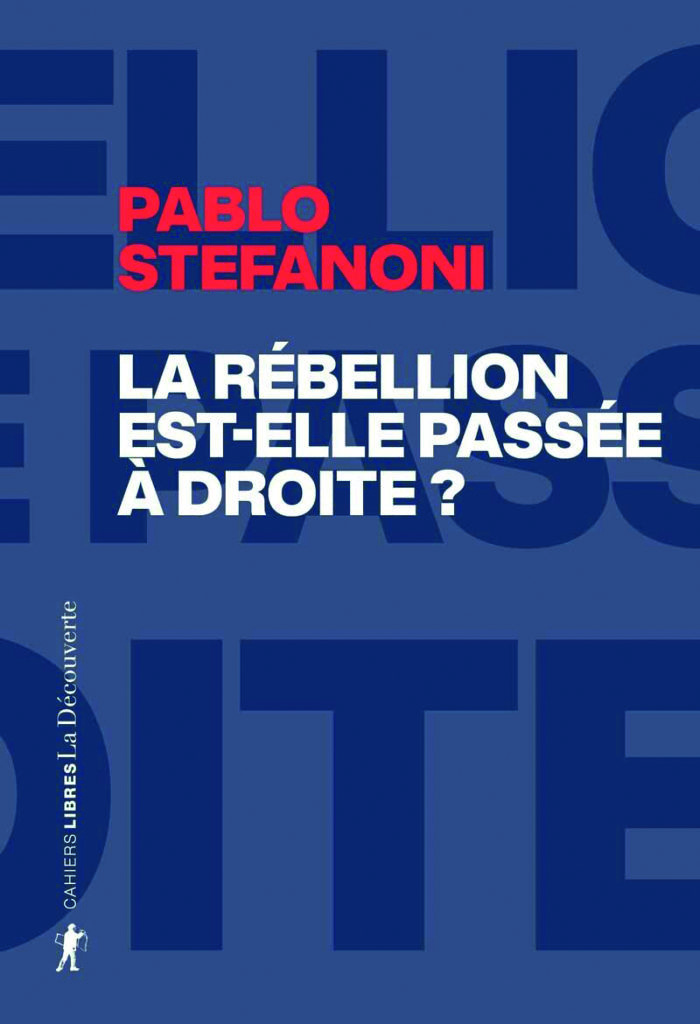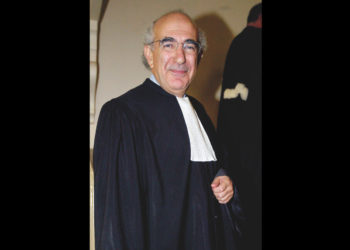Propos recueillis et traduits par Mikaël Faujour, journaliste
Article publié dans Le DDV n°694
Vous analysez un phénomène d’envergure mondiale aux formes très hétérogènes. De quelles droites parle votre livre ? Quelles sont leurs divergences et leurs points communs ? Surtout, comment qualifier cette « vague » plurielle, souvent nommée à gauche « néo-réactionnaire » ou « néo-fasciste » ?
Les « droites radicales », ou tout simplement les extrêmes droites, font en effet partie d’une mouvance très hétérogène, avec des points de vue différents sur maintes questions. Les partis eux-mêmes changent aussi de positions. Par exemple, en Europe, plus personne aujourd’hui ne parle de sortir de l’Union européenne. Malgré cela, s’il n’existe pas une « internationale réactionnaire » stricto sensu, il y a bien en revanche un espace commun construit sur la base de l’anti-wokisme.
L’anti-progressisme est le « liant » actuel des extrêmes droites qui ont, par ailleurs, des positions distinctes sur l’État et le marché, la géopolitique, la religion ou la laïcité. Ce liant se forme par des voies institutionnelles aussi bien que par la circulation de discours sur Internet. Ce qu’explore le livre est moins la « fachosphère » en elle-même que les discours anti-système, le thème de l’ « esprit de révolte » à droite, mais aussi pourquoi ces droites captent une part significative de l’anticonformisme social et de quelle manière elles le font.
Le livre est paru en janvier 2021, trois ans avant l’accession à la présidence de l’Argentine de Javier Milei. Quels indices laissaient penser que son élection était probable ?
J’ai écrit le livre entre 2019 et 2020. Milei était alors un économiste excentrique qui apparaissait régulièrement à la télévision : il y insultait l’économiste britannique John Maynard Keynes, mort en 1946, faisait salle comble en présentant ses livres dans de grands auditoriums et tenait même le rôle principal d’une pièce de théâtre. À l’époque, je ne pensais pas qu’il pourrait arriver à la présidence. En revanche, on pouvait constater qu’il captait l’attention de beaucoup de jeunes à travers un discours de droite, libertarien, ce qui était nouveau en Argentine.
Beaucoup de ses sympathisants commençaient à lire le libertarien new-yorkais Murray Rothbard et la philosophe russo-étatsunienne Ayn Rand. Je me suis intéressé à ce phénomène, alors dédaigné par la majorité des politologues, parce que Milei incarnait un phénomène qui dépassait les frontières de l’Argentine. Il s’agissait d’une curieuse importation intellectuelle, qui était un symptôme de quelque chose de plus profond. Puis Milei s’est lancé en politique et, contre toute attente, a attiré une grande partie de l’électorat. Il s’est approprié le slogan « Qu’ils s’en aillent tous ! », scandé durant la crise économique de 2001 et a présenté l’élection comme un plébiscite contre la « caste » et les « les politiciens fils de pute » (sic).
Quelles leçons peut-on tirer de sa première année de présidence ?
Milei a une vision messianique de la politique et de lui-même. Il s’est plusieurs fois comparé à Moïse ! Il incarne aussi l’utopie libertarienne et anarcho-capitaliste. Il a lui-même dit qu’il est « une taupe venue détruire l’État de l’intérieur ». Tout cela pose évidemment divers problèmes au moment de gouverner, beaucoup de tensions et de contradictions. En outre, Milei a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne croit pas à la démocratie.
La droite radicale est parvenue à convaincre beaucoup d’électeurs qu’aujourd’hui les élites sont de gauche et que la droite est celle qui représente les « petites gens », les « gens normaux ». Il est important, sans le moindre doute, que la gauche renverse ces perceptions.
En pratique, le projet libertarien, mis en application, est un type de néolibéralisme autoritaire, teinté d’idées issues de ce que l’on a nommé l’ « alt right » (droite alternative), par exemple le discours contre le « globalisme », « l’idéologie mondialiste » et l’ONU, présenté comme un club de gauchistes. Sous sa présidence, certaines choses ont été libéralisées – il a dit qu’il a mis en place « le « programme de choc » le plus radical de l’histoire de l’humanité » – mais il maintient pour l’instant le contrôle des changes et d’autres politiques « étatistes ». Par ailleurs, il est favorable au renforcement des forces armées et de la police, ce qui contrevient au libertarianisme traditionnel.
Il est encore trop tôt pour savoir comment son gouvernement va se stabiliser politiquement et idéologiquement. Milei parie sur un type de populisme de droite qui puisse le faire passer pour le líder máximo, une sorte de super-héros de jeux vidéo.
Comment expliquez-vous cette appropriation par la droite de codes de rébellion contre-culturelle qui appartenaient historiquement à la gauche ?
La nouvelle ère que Giuliano Da Empoli a caractérisé comme « colère + algorithmes » et Martin Gurri comme la « révolte du public » semble générer un type de non-conformisme plus facile à récupérer pour la droite radicale. Le futur apparaissant comme « clos » à toute amélioration de la vie sociale, une grande part de ce non-conformisme tourne au ressentiment.
La droite radicale est parvenue à convaincre beaucoup d’électeurs qu’aujourd’hui les élites sont de gauche et que la droite est celle qui représente les « petites gens », les « gens normaux ». Il est important, sans le moindre doute, que la gauche renverse ces perceptions. Il est significatif, d’ailleurs, que le candidat à la vice-présidence des États-Unis et colistier de Kamala Harris, Tim Walz, ait qualifié la droite « trumpiste » de « bizarre » (weird). Mais cela n’a pas suffi à inverser la campagne efficace de Trump, qui s’est avéré imbattable et a montré que sa victoire de 2016 n’était pas le fruit du hasard.
Le futur de la gauche est, pour une bonne part, lié à sa capacité de restaurer les représentations parmi les gens ordinaires. Ce n’est pourtant pas une chose aisée : la social-démocratie connaît une forte crise d’identité – et de suffrages – et les gauches radicales, sauf exceptions, ne sont pas parvenues à damer le pion des sociaux-démocrates.
Le discours « anti-diversité » peut facilement tomber dans la nostalgie et, dans les cas extrêmes, dans la paranoïa civilisationnelle.
Les sociétés sont devenues plus ouvertes à la diversité, plus progressistes sur le plan culturel, mais en même temps plus inégalitaires en matière sociale. Et il y a là un nœud qui stimule une situation de confusion politico-idéologique. Il ne s’agit pas seulement des partis. La culture de gauche – avec ses panthéons, ses chansons, ses symboles, son « économie des émotions » – rassemble beaucoup moins que par le passé. La droite semble, pour le moment, se contenter d’agiter les étendards de la communauté – avec un discours nationaliste xénophobe – et de la liberté – captant des sensibilités associées au néo-entrepreneuriat propre à l’époque. La gauche a également des choses à dire sur ces deux questions. Nous vivons une sorte d’ « interrègne » ; il faut voir comment tout cela va se stabiliser dans un proche avenir.
Dans quelle mesure considérez-vous, comme le journaliste espagnol Daniel Bernabé dans Le piège identitaire (L’échappée, 2022), que la gauche doit s’ancrer surtout dans des problématiques liées au travail et aux conditions matérielles de vie comme base commune de lutte ?
Je suis d’accord avec le fait que la gauche doit retrouver le lien avec les gens « normaux » et débattre davantage d’économie et de thèmes « classiques » comme la santé, l’éducation publique et les transports. Mais, au-delà de ce livre-là, qui s’inscrit dans un rejet du « néolibéralisme progressiste », une bonne partie de l’anti-wokisme de gauche parle de la classe ouvrière sans avoir aucun effet sur celle-ci. Les nouvelles classes ouvrières sont « diverses », traversées par de nouvelles sensibilités socioculturelles, avec des relations au lieu de travail différentes de celles du passé, et d’origines ethniques multiples. Le discours « anti-diversité » peut facilement tomber dans la nostalgie et, dans les cas extrêmes, dans la paranoïa civilisationnelle.
Il n’est pas vrai que la gauche ne parle pas de questions matérielles. Le problème est que, souvent, le discours économique de la gauche n’est pas très crédible et qu’il est difficile de mettre en œuvre des réformes sociales consistantes dans le cadre d’un espace national – et quasi impossible dans le cadre d’espaces transnationaux. Il n’est pas vrai non plus que les gouvernements progressistes ouvrent les frontières ou ne luttent pas contre la criminalité. En somme : ni Pedro Sánchez n’ouvre les frontières de l’Espagne, ni Giorgia Meloni ne parvient à fermer celles de l’Italie.
À mon avis, il faut évaluer sur quoi mettre l’accent, mais il ne faut pas s’obséder avec le wokisme – un concept à géométrie variable – et les fantasmes que génère la prétendue « prise en otage de l’Occident ».