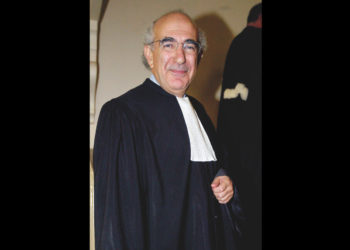Propos recueillis par Alain Barbanel, journaliste
Israël-Palestine, année zéro, c’est le titre du livre que vous co-signé avec des contributions d’activistes et d’intellectuels israéliens et palestiniens qui militent pour la paix. Pourquoi avoir choisi ce titre ?
C’est une allusion au chef d’œuvre de Roberto Rossellini, Allemagne Année zéro (1947). Avec une approche quasi documentaire, ce film relate la lente dérive d’un enfant déambulant dans les ruines d’un Berlin dévasté par la guerre. Ce titre s’est imposé à moi comme une métaphore puissante des massacres du 7-Octobre et de leurs conséquences : une régression cauchemardesque vers la violence extrême provoquant une dévastation sans précédent et un niveau d’hostilité totale entre belligérants s’affrontant désormais dans un combat de nature existentielle.
Le 7-Octobre n’est pas réductible à la litanie des violences qui ont émaillé l’histoire pourtant centenaire de ce conflit. C’est un tournant historique majeur aux répercussions mondiales, à la fois géopolitiques et sociétales. Comme observateur, j’ai été saisi par l’horreur du 7-Octobre et ses conséquences. J’ai également été scandalisé par l’instrumentalisation politique qui en a été faite, notamment par la gauche radicale en France, au Canada et aux États-Unis. Mais le paradoxe de cette terrible séquence historique, c’est qu’elle a rebattu les cartes au Levant. L’année zéro du conflit israélo-palestinien, c’est aussi la possibilité d’un nouveau départ, d’une reconstruction à la fois morale et matérielle qui pourrait, espérons-le, permettre aux deux sociétés de sortir de l’impasse de cette guerre sans fin.
Plusieurs auteurs de votre livre font le constat que tous ceux qui cherchent une issue au conflit butent sur l’exacerbation des radicalités chez les belligérants en particulier à propos de la religion. Est-ce, selon vous, le carburant de ce conflit ?
Je pense que notre eurocentrisme nous a conduit à sous-estimer l’influence du facteur religieux sur la dynamique conflictuelle israélo-palestinienne. Contrairement à ce qui est répété avec plus ou moins de bonne foi, l’émergence du Hamas sur la scène palestinienne n’est pas une simple réaction à l’occupation israélienne. Le nom même de la branche militaire du mouvement militaro-terroriste palestinien, les brigades Izz al-Din al-Qassam, fait référence à une figure emblématique de l’islamisme armé qui sévissait déjà en Palestine mandataire au début des années 20 du siècle dernier. Le Hamas s’enracine en effet dans l’islam politique issu de la confrérie des Frères musulmans dont il est la branche palestinienne. Son opposition principielle au mouvement sioniste est d’ordre politico-religieuse. Le Hamas est un mouvement jihado-nationaliste fondamentaliste, suprémaciste et antisémite. Israël et le monde juif ne constituent pas à ses yeux un ennemi réel avec qui une coexistence pourrait être envisageable à terme mais un ennemi absolu qu’il faut combattre jusqu’à sa disparition. Pour les islamistes du Hamas, il ne peut pas y avoir de compromis possible avec le mouvement national juif car la terre de Syrie-Palestine conquise au VIIe siècle par les Arabes est sacrée puisqu’elle a été arrachée à l’Empire byzantin au terme d’une « guerre sainte » (jihad) destinée à propager l’islam. Cette terre étant musulmane pour l’éternité, c’est l’existence même d’Israël qui est un scandale théologico-politique aux yeux des jihado-nationalistes palestiniens. L’influence du facteur religieux au sein du mouvement national palestinien est donc ancienne. Sa place a pris une importance particulière depuis les années 1990 et l’effondrement du processus de paix. L’affaiblissement du Fatah et plus largement du nationalisme arabe de tendance laïque a permis au Hamas et au Jihad islamique de monter en puissance. Pour ces derniers, la création d’un État palestinien n’est pas une fin en soi. C’est la sacralité du territoire qui prime et doit revenir dans le giron du Dar al-Islam (« la demeure de l’islam »).
Côté israélien, le rôle du facteur religieux est également ancien…
Dès la fin du XIXe siècle, le sionisme religieux émerge comme un courant certes périphérique du mouvement national juif, mais dont la montée en puissance s’est avérée inexorable en raison notamment de la dynamique démographique qui le porte. Originellement centriste et dotée d’une branche socialisante et ouvriériste, il bascule vers la droite dure après la guerre des Six jours qui signe les retrouvailles de l’État d’Israël moderne avec les territoires des anciens royaumes de Juda et d’Israël, le berceau historique du peuple juif. Une nouvelle génération de militants nationalistes religieux émerge alors et s’installe en « Judée-Samarie » où des implantations voient le jour pour favoriser l’annexion rampante de la Cisjordanie et tuer dans l’œuf toute perspective de solution à deux États. Smotrich et Ben Gvir incarnent l’aile la plus radicale de cette mouvance néo-messianiste qui est désormais aux manettes grâce à son alliance avec Netanyahou.
En Israël comme en Palestine, on assiste donc à un double processus de confessionnalisation du conflit, majoré par l’absence totale de négociations diplomatiques bilatérales depuis 2014.
En Israël comme en Palestine, on assiste donc à un double processus de confessionnalisation du conflit, majoré par l’absence totale de négociations diplomatiques bilatérales depuis 2014. La guerre déclenchée par l’attaque terroriste du Hamas a considérablement durci les positions des deux camps. Il faut avoir à l’esprit que les générations actuelles ne connaissent que le fracas des armes avec des pics d’affrontements réguliers qui n’ont jamais cessé depuis le lancement de la seconde Intifada. Cette génération post-Oslo est aussi sceptique que désespérée quant à la possibilité de parvenir à une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. Les Gazaouis âgés de moins de 18 ans sont nés sous la férule du Hamas. De même côté israélien, la jeunesse a fait ses premiers pas en politique sous le règne quasi ininterrompu de Netanyahou.
Après le pogrom du 7-Octobre et la guerre meurtrière qui a suivi, est-il encore envisageable de penser que le « jour d’après » amènera chaque belligérant à changer le regard qu’il porte sur son ennemi d’aujourd’hui ?
Les Israéliens et les Palestiniens sont traumatisés. Les deux peuples continuent d’enterrer leurs morts. Le travail de deuil est à peine entamé. La guerre est par ailleurs loin d’être terminée. La reprise des combats en témoigne. Un changement de regard croisé prendra donc du temps. Il n’est envisageable à terme que si un véritable processus d’introspection émerge de part et d’autre. Ce cheminement intellectuel et moral doit concerner aussi bien le personnel politique que les sociétés civiles des deux camps. Or, côté palestinien, y compris au sein du Fatah de Mahmoud Abbas, les massacres du 7-Octobre n’ont toujours pas été condamnés en tant que tels. Côté champ politique israélien, fort peu de voix s’émeuvent du bilan humain à Gaza.
Mais si cette guerre durcit les antagonismes, elle a aussi réveillé les consciences. Dans les deux camps, des personnalités issues de la société civile et notamment les intellectuels et les activistes pro-coexistence, font entendre leurs voix. Le livre que j’ai coordonné en est la preuve. Mes contributeurs israéliens et palestiniens ont accepté de dialoguer alors même que la guerre faisait encore rage. Ces hommes et ces femmes se battent au quotidien pour que le vent mauvais de la haine n’emporte pas tout sur son passage. Le réveil est très impressionnant au sein de la société civile israélienne. Il s’appuie notamment sur le mouvement de protestation anti-gouvernemental et pro-démocratie né de l’opposition à la réforme illibérale de la justice que Netanyahou et sa coalition ont tenté d’imposer au forceps. Des élections auront par ailleurs lieu d’ici un an et demi, et tout laisse à penser qu’une coalition de partis centristes libéraux anti-Netanyahou succédera au gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël. Pour les Palestiniens, cela devra passer par une refonte de la gouvernance et notamment de l’Autorité palestinienne actuellement dirigée par un Abbas démonétisé et dont la corruption et les dérives autocratiques sont dénoncées de toutes parts. L’Autorité palestinienne devra par ailleurs restaurer son autorité sur la Cisjordanie où prolifèrent les milices armées et où le Hamas et ses alliés tentent de la renverser.
De manière plus fondamentale encore, c’est au parachèvement du processus de reconnaissance mutuelle que les leaderships des deux peuples devront s’atteler.
Vous évoquez une reconnaissance mutuelle. Mais depuis les accords d’Oslo, cela n’a fait qu’empirer ?
On attendait beaucoup des accords d’Oslo mais l’esprit de compromis sur lequel ils étaient bâtis n’a pas résisté à l’assassinat de Rabin, au terrorisme palestinien et à la colonisation israélienne. Cet échec peut être mis au compte d’un travail de reconnaissance mutuelle qui n’avait en réalité pas été mené à son terme. Deux blocages cognitifs majeurs continuent de faire obstacle à la solution à deux États dont l’horizon ne cesse de s’éloigner. D’un côté, le mythe de la libération de toute la « Palestine historique » (la Palestine dans les frontières mandataires incluant le territoire de l’actuel État d’Israël) et d’une application stricte du « droit au retour » qui provoquerait à terme la disparition de l’État juif. De l’autre, celui du recouvrement de « l’entièreté de la Terre d’Israël » qui englobe l’actuelle Cisjordanie et la bande de Gaza. Ces deux narratifs absolutistes – la Grande Palestine et le Grand Israël – sont incompatibles avec une solution à deux États. Ils s’alimentent l’un l’autre car ils sont portés par de puissants acteurs dont le nationalisme exclusiviste rejette toute forme de compromis territorial pour des raisons à la fois politiques et religieuses. Les deux sociétés devront renoncer à ces mythes politiques pour sortir de la spirale infernale dans laquelle elles sont enfermées.
Oui mais c’est sans compter avec le Hamas, qui bien qu’affaibli militairement, est loin d’avoir été éradiqué… Comment fait-on pour venir à bout d’une idéologie mortifère ?
Le maintien du Hamas à Gaza comme force politico-militaire est totalement incompatible avec la solution des deux États. Son idéologie ne peut être éradiquée car elle fait partie intégrante du paysage politique palestinien, mais son influence peut être limitée à la portion congrue. C’est précisément cela l’enjeu. Le Hamas est un mouvement militaro-terroriste mais aussi socio-politique. C’est un Janus à deux têtes. Son appareil politico-militaire peut être détruit mais au prix d’une occupation de la bande de Gaza. Cette occupation pourrait être temporaire à condition de créer les conditions de l’émergence d’une gouvernance alternative au mouvement islamiste palestinien. Or, Netanyahou et ses alliés ne semblent pas avoir retenu la leçon du grand théoricien des conflits armés modernes, Carl von Clausewitz, selon lequel « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens ». Prisonnier de son alliance avec la droite radicale, le Premier ministre israélien se contente de répéter le slogan creux d’une « victoire décisive » contre le Hamas sans jamais offrir de perspective politique de moyen-long terme en dehors d’une attitude suiviste consistant à reprendre à son compte le « plan Trump ».
Le maintien du Hamas à Gaza comme force politico-militaire est totalement incompatible avec la solution des deux États. Son idéologie ne peut être éradiquée car elle fait partie intégrante du paysage politique palestinien, mais son influence peut être limitée à la portion congrue.
Une stratégie du jour d’après pourrait pourtant être mise en œuvre, au moins partiellement là où le Hamas n’existe plus qu’à l’état résiduel. Car en effet, si le mouvement islamiste a survécu aux assauts de l’armée israélienne, il est néanmoins très affaibli militairement. Le Hamas était structuré en proto-armée lors de son raid terroriste du 7-Octobre avec des brigades, des bataillons, des compagnies… Il disposait par ailleurs d’une capacité de production autonome de roquettes et de drones de combat capables de frapper dans la profondeur du territoire israélien. Or cet arsenal a été largement détruit par Tsahal. Le lancement, au milieu de la nuit du 17 au 18 mars, d’une nouvelle campagne aérienne israélienne contre le mouvement islamiste en est la preuve. Le Hamas est incapable de riposter par des tirs de roquettes massives sur le territoire israélien. Par ailleurs, si le mouvement islamiste est parvenu à recruter des milliers de jeunes Gazaouis, ces derniers sont peu aguerris et bien moins équipés que ne l’étaient leurs prédécesseurs.
Le mouvement est-il soutenu par la population gazaouie ?
Le soutien dont il bénéficie est loin d’être aussi massif qu’il ne le prétend. Ne soyons pas dupes des mises en scène calibrées du mouvement terroriste palestinien. Ce dernier a profité de la première phase de cessez-le-feu pour accréditer la thèse fallacieuse d’une puissance militaire inentamée et d’une popularité intacte. Or les images satellite sont sans appel. Il n’y avait pas foule. La pseudo victoire du Hamas sur Israël relève de la pure propagande. Une propagande en forme de guerre psychologique dont on a pu constater le caractère particulièrement sordide lors de la remise des cercueils des enfants Bibas et de leur mère.
Quelles sont les cartes à jouer ?
Le face à face israélo-palestinien est voué à la répétition du pire. Seule une sortie de crise régionale pourrait permettre aux deux nations de s’extraire de l’ornière. J’interprète de ce point de vue les déclarations fracassantes et surréalistes de Trump sur la création d’une « riviera » à Gaza comme relevant d’une stratégie de négociation maximaliste s’adressant en réalité aux pays arabes. Le président américain entend les contraindre à présenter un plan alternatif crédible, capable de répondre au triple défi de la reconstruction de l’enclave côtière, de sa gouvernance post-Hamas et de la sécurité à apporter à Israël. C’est précisément ce qui est en train de se dérouler avec la tenue des sommets arabes de Ryad puis du Caire. Les Saoudiens y jouent un rôle majeur mais des désaccords subsistent, notamment entre l’Égypte et la Jordanie d’une part et l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis d’autre part. Les premiers proposent un plan de reconstruction de l’enclave palestinienne évalué à 53 milliards de dollars sur cinq ans garantissant aux 2,1 millions d’habitants de Gazaouis de rester sur place. Dans le même temps, la bande de Gaza serait temporairement administrée par un comité de « soutien social » composé de technocrates palestiniens, avant que l’Autorité palestinienne n’en reprenne le contrôle dans un délai de six mois.
Est-ce réaliste ?
Les Saoudiens et les Émiriens doutent de la viabilité de ce plan et s’inquiètent notamment de l’absence de structure de gouvernance crédible et de cadre sécuritaire robuste. La proposition égypto-jordanienne préconise en effet la formation d’une police palestinienne et la présence de forces de maintien de la paix de l’ONU sans que le Hamas ne soit désarmé, solution jugée inacceptable par Israël et les États-Unis. Les Saoudiens et les Émiriens savent pertinemment qu’ils compteront parmi les principaux contributeurs de la reconstruction de la bande de Gaza. Or celle-ci sera à la merci du Hamas si ce dernier n’est pas désarmé. Le mouvement islamiste pourrait continuer à tirer les ficelles à la manière du Hezbollah au Liban avant la défaite de la milice islamiste chiite pro-Iran face à Israël. Pour assurer sa survie, le Hamas est capable de dire tout et de faire exactement le contraire en se réarmant comme il le fait déjà par le détournement de l’aide humanitaire et en préparant de nouvelles attaques via le recrutement de nouveaux combattants, ce qui conduira mécaniquement les Israéliens à riposter et donc occasionnera de nouvelles destructions dans l’enclave côtière. C’est d’ailleurs précisément ce qui est en train de se dérouler à Gaza avec la reprise des hostilités par Israël. Or Ryad et Abu Dhabi ne veulent pas être les dindons de la farce et payer pour une reconstruction qui s’avèrera temporaire car soumise aux velléités jihadistes du mouvement terroriste palestinien.
Il n’y aurait pas d’autres hypothèses ?
L’envoyé spécial des États-Unis pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, a proposé la libération d’une dizaine otages israéliens vivants (sur les 28 croupissant encore dans les geôles de Gaza) en échange d’une prolongation du cessez-le-feu de quarante-deux à soixante jours, ce qui correspond à la fin des fêtes de Ramadan et de Pessah. Au-delà de cette période, l’émissaire américain annonce qu’un cessez-le-feu permanent pourrait être mis en œuvre au terme duquel la totalité des otages serait libérée et la reconstruction de la bande de Gaza pourrait alors commencer mais il conditionne cette reconstruction à la démilitarisation de l’enclave côtière, ce que le mouvement islamiste palestinien ne semble pas prêt à faire.
Le face à face israélo-palestinien est voué à la répétition du pire. Seule une sortie de crise régionale pourrait permettre aux deux nations de s’extraire de l’ornière.
Des contacts directs ont été établis entre l’administration Trump et le Hamas. C’est sans précédent car les États-Unis considèrent le Hamas comme une organisation terroriste depuis 1997. La révélation par le site américain Axios de ces négociations secrètes a provoqué des tensions entre le gouvernement israélien et certains responsables de l’administration états-unienne, notamment l’émissaire américain pour les otages, Adam Boehler. Le Hamas et les États-Unis discuteraient d’une trêve de 5 à 10 ans à Gaza et en Cisjordanie, comprenant la libération de la totalité des otages israélien, un retrait de Tsahal de la bande de Gaza, la libération de prisonniers palestiniens et le désarmement du mouvement islamiste palestinien qui serait exclu de tout rôle civil et/ou politique. Le Hamas aurait accepté de renoncer à ses armes « offensives » – missiles, roquettes, obus d’artillerie, drones – mais pas « défensives » (fusils d’assaut, grenades, explosifs, RPG…) même après la création d’un hypothétique État palestinien.
Quelles sont les chances de ces plans ?
Le plan « Boehler » est plus ambitieux que celui proposé par Witkoff mais il a peu de chance d’aboutir. Les Israéliens et l’Autorité palestinienne ont vertement critiqué Bohler. Les contacts directs initiés par l’émissaire américain pourraient selon eux contribuer à remettre le Hamas en selle alors même que le mouvement islamiste est isolé sur la scène régionale et internationale. Les négociations sont actuellement dans l’impasse et il faut interpréter la reprise des hostilités comme relevant d’une stratégie israélienne visant à faire pression sur le Hamas pour que ce dernier accepte la proposition Witkoff. Rien ne dit cependant que le mouvement islamiste entende raison et Netanyahou ne semble pas exempt de calculs politiques. Le Premier ministre israélien poursuit ses attaques contre l’État de droit et tente de se débarrasser des garde-fous institutionnels pour échapper aux fourches caudines de la justice de son pays. La reprise de la guerre est donc une aubaine pour lui alors sa coalition vacillait sur ses bases à la veille de l’adoption du budget annuel dont dépend sa survie politique.
L’administration américaine a-t-elle une stratégie claire ?
Elle tâtonne. La position de Trump est difficile à lire d’autant que des dissensions apparaissent au sein de son équipe. Le président américain semble privilégier la libération des otages et la fin des hostilités pour enclencher un processus menant à une normalisation israélo-saoudienne. Il manie pour ce faire une stratégie de la carotte et du bâton. Les négociations avec le Hamas et Téhéran (en vue d’un nouvel accord sur le nucléaire) ayant pour l’heure échoué, le président américain utilise désormais la manière forte, notamment contre le mouvement islamiste chiite pro-Iran des Houthis du Yémen qui a repris ses attaques contre les navires transitant par la mer Rouge. Par ailleurs, Donald Trump met ses menaces à exécutions vis-à-vis du Hamas, lui qui avait promis un « enfer » au mouvement islamiste si ce dernier ne relâchait pas tous les otages israéliens.
Cette stratégie de la carotte et du bâton avait montré son efficacité lors de la prise de fonction du président américain et abouti au lancement de la première phase de cessez-le-feu mais la deuxième phase n’a jamais vu le jour tant les intérêts des deux belligérants sont diamétralement opposés. Le Hamas souhaiterait devenir un État dans l’État et conserver à minima ses armes « défensives » pour maintenir de manière indirecte sa férule sur la bande de Gaza. Israël souhaite détruire le mouvement terroriste palestinien et démilitariser l’enclave côtière mais pourrait accepter à minima le désarmement total du Hamas et l’exfiltration de ses chefs à l’étranger.
L’avenir de la bande de Gaza reste donc flou…
Ce qui est certain, c’est que l’Égypte et les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite joueront un rôle clé dans la phase de reconstruction et de gouvernance post-Hamas. Il est possible qu’une force d’interposition américano-arabe transitoire soit installée pour maintenir l’ordre public si le cessez-le-feu venait à être restauré puis pérennisé, mais à condition que le Hamas renonce à la gouvernance de l’enclave côtière. La reconstruction prendra cinq à dix ans et il faudra dans le même temps ouvrir un horizon diplomatique pour relancer une dynamique vertueuse de négociations entre Israéliens et Palestiniens. L’alternative se dessine déjà sous nos yeux. C’est la reprise de la guerre avec une intensité décuplée, la mise en danger de la vie des otages encore vivants et à terme, l’occupation de la bande de Gaza par Israël si aucune solution politique n’est trouvée dans l’intervalle. Cette occupation aurait un coût diplomatique, économique et militaire très lourd pour l’État juif et reporterait sine die toute perspective de normalisation israélo-saoudienne mais Israël semble prêt à en payer le prix tant le traumatisme du 7-Octobre hante encore ce pays engagé dans une guerre qu’il estime existentielle.
L’Iran sort aussi très affaibli de ce conflit mais la « mollarchie » tient bon pour l’instant. La paix n’est-elle pas, en fait, conditionnée par la chute de ce régime et par voie de conséquence de son bras armé, le Hezbollah ?
L’affaiblissement du régime iranien peut aussi le conduire à faire le choix de la nucléarisation en franchissant le seuil. C’est un débat récurrent qui agite les autorités de ce pays. En Israël, des personnalités de premier plan de l’appareil sécuritaire – Mossad, Aman, Shin Beth – estiment que c’est le moment ou jamais de détruire les sites nucléaires iraniens, voire, si les Américains acceptent de se joindre aux Israéliens, de provoquer la chute du régime des mollahs. Ce n’est manifestement pas la ligne privilégiée par Donald Trump dont la stratégie dite de « pressions maximales » vise à négocier un nouvel accord sur le nucléaire avec les Iraniens. Le président américain a d’ailleurs envoyé une lettre en ce sens à Ali Khamenei, le guide suprême iranien et ultime décisionnaire s’agissant de la doctrine nucléaire du régime des mollahs. Si ce dernier a jugé « imprudentes » les menaces de Donald Trump de recourir à la force en cas de refus iranien de la proposition américaine, il n’en reste pas moins que Téhéran est au pied du mur. Le régime des mollahs est plus que jamais affaibli avec la perte de son allié syrien et l’affaiblissement de son réseau de proxys.
Pour autant, Trump ambitionne d’être un « faiseur de paix » et cherche avant tout à stabiliser le Moyen-Orient en sous-traitant la sécurité régionale à ses partenaires historiques que sont Israël et l’Arabie saoudite. Nationaliste et mercantiliste, il souhaite obtenir des Saoudiens qu’ils investissent près de 1 000 milliards de dollars dans l’économie américaine.

Israël-Palestine, Année Zéro
Par David Khalfa
Préface d’Élie Barnavi
Pour mieux cerner les enjeux géopolitiques, diplomatiques et militaires qui se jouent depuis le pogrom islamiste du 7-Octobre, ce livre regroupe entre autres les contributions d’activistes, d’intellectuels et d’observateurs des deux camps, Israéliens et Palestiniens. Quelle sortie de crise ? Quelles conditions nécessaires pour envisager l’instauration d’une paix durable ? Quels rôles pourraient jouer les pays arabes du Levant et du Golfe ? Autant de pistes qui, au-delà de cette tragédie, ouvrent des fenêtres d’espoir avec, en toile de fond, la nécessité de faire émerger une nouvelle offre politique de la part de ces deux peuples condamnés à vivre côte à côte.
Éditions Le Bord de l’eau Documents, 314 pages, prix : 16,00 €