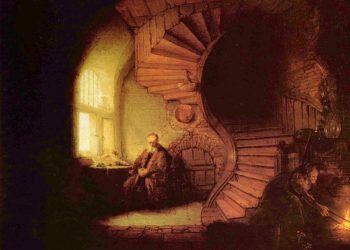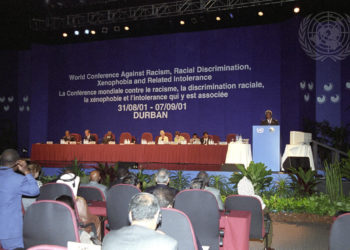Sébastien Ledoux, maître de conférence à l’université de Picardie Jules Verne, historien spécialiste des questions mémorielles*
Le président Emmanuel Macron vient de décider de créer une journée de commémoration nationale en hommage à Alfred Dreyfus fixée au 12 juillet. La première aura lieu sous sa présidence dans un an, le 12 juillet 2026, à l’occasion des 120 ans de l’arrêt de la Cour de cassation innocentant définitivement le capitaine en 1906, ce qui mit fin à « l’affaire Dreyfus » commencée douze ans plus tôt. Si Dreyfus apparait au centre de cette décision dans le communiqué présidentiel, le choix de la date renvoie à la fois à l’homme, décédé le 12 juillet 1935, et au contexte plus large de l’affaire qui prit son nom. La date choisie célèbre en effet également l’indépendance d’une institution républicaine qui s’oppose alors au pouvoir militaire. Le capitaine Dreyfus est condamné par un tribunal militaire une première fois en 1894 pour haute trahison à la dégradation et à la déportation. Déporté de 1895 à 1899 dans un bagne de Guyane, il est de nouveau reconnu coupable par le conseil de guerre de Rennes cette année-là, alors qu’une intense mobilisation a été initiée par de nombreux acteurs (artistes, journalistes, politiques) pour clamer son innocence, dont le fameux J’accuse de Zola publié le 13 janvier 1898.
Que commémorer ?
Fondée sur une documentation rassemblée par les magistrats de la Cour de cassation, la décision du 12 juillet 1906 symbolise aussi le triomphe de la vérité des faits qui ont été tordus à plusieurs reprises par l’armée pour accuser un homme innocent de haute trahison avec l’Allemagne, alors que la période est à la revanche, suite à la défaite française de 1871. La décision du 12 juillet constitue enfin un acte par lequel l’institution judiciaire s’affranchit de l’antisémitisme virulent manifesté tout au long de « l’affaire Dreyfus » et qui se poursuit ensuite. Lors de la panthéonisation de Zola en 1908, Dreyfus est blessé par une balle tirée par un journaliste nationaliste qui plaidera à son procès « la légitime défense contre le dreyfusisme » et contre la réhabilitation de 1906 qualifiée de « page avilissante de notre histoire ». Il sera acquitté.
Le choix d’une commémoration plutôt qu’une panthéonisation de Dreyfus, réclamée depuis 2006, comme le choix de la date à commémorer constituent une réponse à une question qui s’est régulièrement posée au pouvoir politique. Que commémorer d’Alfred Dreyfus ? Sa naissance, sa condamnation de 1894 ou sa réhabilitation de 1906 ? Qui commémorer ? Dreyfus lui-même, mais alors comme héros ou comme victime ? Ou ses défenseurs parmi lesquels le général Picquart, Zola, Clemenceau, Jaurès ou Bernard Lazare qui se sont engagés dans « l’affaire Dreyfus », considérée traditionnellement comme l’acte de naissance de la figure de l’intellectuel ?
Des réponses politiques embarrassées
Alors que l’extrême droite met régulièrement en doute au cours du XXe siècle son innocence par les voix de Barrès ou de Maurras, ou plus récemment de Zemmour, ces questions mémorielles sont posées au pouvoir politique depuis une quarantaine d’années.
Les aléas de la statue de Dreyfus à Paris expriment bien le caractère incertain des politiques mémorielles dont il est l’objet. Réalisée en 1985 avec son sabre brisé par l’artiste Tim, la statue doit être inaugurée selon le choix du ministre de la Culture, Jack Lang, dans la cour de l’École militaire. Dreyfus y a été dégradé le 5 janvier 1895 au cours d’une cérémonie pendant laquelle son képi, ses galons et ses boutons lui sont retirés avant de briser son sabre en deux. Mitterrand s’oppose à ce lieu considérant qu’on ne peut honorer un « remords » au sein de l’institution militaire. Proposée ensuite place Dauphine face à la Cour de cassation, elle est finalement inaugurée en 1988 au jardin des Tuileries avant d’être déplacée par le maire de Paris, Jacques Chirac, sur le boulevard Raspail en 1994 pour le centenaire de sa condamnation. À l’occasion du centenaire de sa réhabilitation cette fois, le maire de Paris Bertrand Delanoë et Jack Lang propose en 2006 de la transférer dans la cour de l’École militaire, alors qu’elle a été vandalisée par un tag antisémite en 2002, mais ils font face au refus de l’armée. Sur le plan national, le gouvernement Balladur comme le président Mitterrand décide de ne rien faire en 1994, alors qu’un film d’Yves Boisset sur l’affaire sort en salle l’année suivante : comment commémorer un événement négatif qui a divisé les Français ?
Panthéoniser Dreyfus ?
Les initiatives politiques se multiplient en revanche pour le centenaire du J’accuse de Zola en 1998 : différents hommages sont rendus par le président de l’Assemblée nationale Laurent Fabius, le président Chirac, le premier ministre Jospin et le ministre de la Défense au grand intellectuel défendant héroïquement la vérité et la liberté. Des querelles sur l’héritage historique d’une gauche dreyfusarde oppose des parlementaires de droite à Lionel Jospin. Mais si Dreyfus est régulièrement présent dans les discours de l’époque, sa position secondaire derrière Zola est très significative quant à la difficulté du politique à l’instituer comme personnage central des actions mémorielles officielles.
Le débat resurgit à l’occasion du centenaire de sa réhabilitation de 1906. Publiant une biographie, Alfred Dreyfus. L’honneur d’un patriote (Fayard), l’historien Vincent Duclert propose de panthéoniser Dreyfus en mettant en avant ses propres combats contre sa condamnation, puis pour sa réhabilitation, mais aussi pour la réhabilitation de sa carrière militaire après 1906 ou son dévouement pendant la Première Guerre mondiale. Dreyfus est ainsi présenté en héros républicain et non plus en simple victime de l’injustice et de l’antisémitisme. Cette proposition est relayée dans la presse et par différentes personnalités dont Jack Lang, mais le président Chirac la décline : que ferait Dreyfus, avant tout victime, parmi les « grands hommes » qui comptent d’ailleurs déjà ses défenseurs Zola et Jaurès ?
Un contexte plus immédiat post-7 Octobre
La très forte augmentation des actes antisémites en France depuis le 7 octobre 2023 a entrainé une initiative parlementaire récente sur l’un des principaux symboles nationaux de l’antisémitisme français – avec Vichy – en la personne de Dreyfus. Contestée par le groupe Modem pour l’instrumentalisation par le RN et LFI de la question de l’antisémitisme, elle a fait l’objet d’un vote de l’Assemblée nationale le 2 juin dernier décernant de façon posthume le grade de général de brigade à Dreyfus alors que sa carrière militaire avait été interrompue en 1894.
Très actif sur le plan mémoriel depuis 2017, le président Macron a manifestement souhaité garder la main sur ce domaine en répondant par la mémoire au contexte d’un antisémitisme virulent au sein de la société. S’il n’a pas retenu lui non plus l’option de la panthéonisation, c’est donc dans une mise en dialogue entre une institution républicaine qui s’est s’affranchie de l’armée, du nationalisme et de l’antisémitisme, et un homme devenu symbole d’un antisémitisme français que se formule la réponse du chef de l’État avec la création de cette commémoration. Est-ce de nouveau une manière de ne pas centrer l’action mémorielle sur Dreyfus lui-même malgré les combats qu’il mena ? De nouveau, que commémorer ? Dreyfus ou l’affaire qui porte son nom ? Le choix du 12 juillet esquisse une synthèse intégrant les deux.
* Dernier ouvrage paru : Vichy était-il la France ? Le Vel d’Hiv et sa mémoire (JC Lattès, 2025)