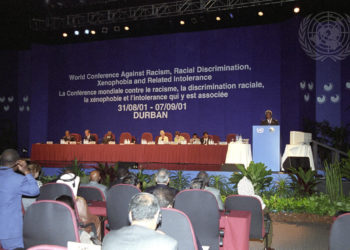Isabelle de Mecquenem, agrégée de philosophie, Directrice adjointe du Réseau de recherche sur le racisme et l’antisémitisme
Les faits qui se sont produits début avril à l’Université de Lyon 2 ont eu rapidement un écho au-delà du monde universitaire local : l’irruption d’un groupe d’individus masqués scandant « Racistes ! Sionistes ! C’est vous les terroristes ! » lors du cours que Fabrice Balanche, maître de conférences en géographie, s’apprêtait à donner, n’a pas seulement montré le caractère agressif que peut prendre le droit à la liberté d’expression politique sur certains campus.
En effet, l’action de ce groupuscule a franchi la ligne rouge qui protège l’exercice des libertés académiques en France, sujet resté pour l’instant peu analysé sur le fond, alors qu’il forme en ce moment le principal motif d’inquiétude des communautés universitaires et des réseaux de chercheurs du monde entier.
Cause commune
L’agression ayant été filmée et diffusée, chacun a pu constater la véhémence dont le petit groupe a fait preuve, usant de l’effet de surprise et de sidération sur un auditoire pacifique. Elle constitue aussi, à travers la personne de l’enseignant, une attaque contre la transmission du savoir et l’autorité qui la fonde, avec des effets délétères potentiels sur l’ensemble du monde académique, déjà fragilisé par les coupes budgétaires notamment.
Par leur mode opératoire, les agissements subis par Fabrice Balanche rappellent ceux relatés par des universitaires lors du mouvement de Mai-68. À cette époque, les étudiants s’attaquaient aux savoirs académiques et à leurs représentants au nom d’arguments politiques. Toutes les sciences, qu’elles portent sur la nature ou la société, étaient perçues comme l’émanation de la bourgeoisie à abattre, selon le témoignage de Georges Gusdorf dans La Nef des fous (1969). Le philosophe, qui était alors professeur à l’Université de Strasbourg, soulignait que tout étant rejeté en bloc par les étudiants, leur contestation globale ne pouvait plus emprunter les voies de la critique et de la discussion avec les enseignants ou l’administration.
Ce qui a changé par rapport à Mai-68, c’est qu’une partie des enseignants des universités fait cause commune avec les étudiants qui animent les « comités Palestine » des campus.
Ce qui a changé par rapport à Mai-68, c’est qu’une partie des enseignants des universités fait cause commune avec les étudiants qui animent les « comités Palestine » des campus et tiennent le même discours dans une version plus élaborée. Selon Gérard Bensussan, philosophe et professeur émérite à l’Université de Strasbourg, il existe « un antisionisme de la chaire », « professé, articulé, argumenté1Des sadiques au cœur pur. Sur l’antisionisme contemporain, Paris, Hermann, 2025, p. 25. Voir la recension de cet ouvrage sur ce site. » qui adopte des méthodes scientifiques pour tenir un discours politique. Les étudiants, ainsi que leurs associations et syndicats, qui se mobilisent contre le « génocide à Gaza » se sentent donc soutenus par une partie du corps professoral, ce qui peut éclairer ce qui s’est passé dans l’amphithéâtre de Lyon 2
Libertés académiques en péril
Sur un plan plus général, le juriste Olivier Beaud, a analysé un ensemble de faits survenus dans le cadre d’enseignements ordinaires à l’Université, montrant que le savoir est véritablement « en danger » dans ce qui devrait être son foyer. Il souligne l’apparition des étudiants comme « nouveaux ennemis des libertés académiques2Le Savoir en danger. Menaces sur la liberté académique, Paris, PUF, 2021, p. 130. » et s’insurge contre l’inertie et la pusillanimité des présidents d’université lorsqu’il s’agit de protéger et défendre leurs enseignants contre des assauts idéologiques, quels que soient leurs natures et leurs motifs. Des enseignants qui vont alors se trouver isolés voire ostracisés par leurs pairs, en vertu de l’adage « Il n’y a pas de fumée sans feu ».
À ce tableau, il faut ajouter la conception irénique de l’enseignement promue par le guide de la laïcité de l’Enseignement supérieur publié par France Universités, c’est-à-dire l’association des Présidents et des chefs d’établissements du supérieur. Ce guide est destiné aux référents laïcité chargés faire connaître et respecter le cadre juridique de l’application de ce principe dans les établissements d’enseignement supérieur. Dans sa dernière mise à jour (2023), on peut ainsi lire la préconisation suivante explicitement destinée aux « enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs » : « Il convient donc d’éviter de poser toute question trop polémique et de prendre en considération tant les opinions potentiellement divergentes des autres enseignantes et enseignants que celles des étudiantes et étudiants, à la fois pendant le cours ou lors de l’examen de fin d’année3Guide de la laïcité dans l’enseignement supérieur, 2023, p. 30.. » Ce conseil, s’il était suivi, mettrait naturellement les libertés académiques en péril, alors qu’elles sont sanctuarisées par la Constitution, et rendrait l’enseignement impossible en l’indexant sur les opinions des étudiants et des collègues.
Polarisation
Dans le cas de l’incident survenu à Lyon 2, dont le point de départ fut un sujet relatif à la laïcité à l’Université ayant valu à Fabrice Balanche l’imputation d’ « islamophobie », une enquête pour « entrave à la fonction d’enseignement » a été ouverte par le Procureur, ce qui place publiquement l’enseignement supérieur au même rang que l’enseignement secondaire qui a connu une montée des contestations d’enseignements selon plusieurs sondages et enquêtes menés depuis 2018. Il faut rappeler que l’entrave à l’enseignement, et, plus précisément : « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant », sont entrés dans le Code pénal (Article 431-1) depuis 2021, à la suite de l’assassinat de Samuel Paty.
On aurait donc pu s’attendre à ce que l’agression de Fabrice Balanche suscite un mouvement de solidarité des académiques. Si leur ministre de tutelle s’est exprimé avec la célérité et la netteté nécessaires, rappelant l’illégalité des agissements du groupe d’activistes, symptomatiquement, le monde universitaire a révélé une polarisation, puisque deux camps se sont manifestés à travers des lettres de soutien et pétitions publiques : l’un soutenant l’universitaire, l’autre, la Présidente de l’Université de Lyon 2. Si le mot de polarisation appartient aujourd’hui au vocabulaire socio-politique courant, il a aussi servi à décrire les suites de l’affaire Dreyfus dans l’opinion et le monde politique. Léon Blum l’emploie dans ses Souvenirs sur l’affaire en 1935.
Combien d’universitaires ont pu se sentir surveillés, intimidés, mis en cause lors de leurs prises de parole en cours en fonction des sujets à forte teneur inflammable qu’ils abordaient, mais aussi, parfois, pour un simple mot ?
Quoique non exhaustifs, ces éléments donnent en tous cas idée de l’acuité de ce qui a pu représenter une « première » dans les universités françaises, et qui a éclaté au grand jour, le 1er avril dernier. Cependant, une telle agression ne germe pas sans un terreau fertile, sans une chaîne implicite de cas précédents, moins manifestes, qui parviennent à créer une pression diffuse constante dès lors qu’ils circulent d’une manière ou d’une autre. Combien d’universitaires ont pu se sentir surveillés, intimidés, mis en cause lors de leurs prises de parole en cours en fonction des sujets à forte teneur inflammable qu’ils abordaient, mais aussi, parfois, pour un simple mot ? Dans la logique de soupçon des « raisonneurs violents », selon l’expression de Diderot, un objet d’étude est nécessairement corrélé aux choix idéologiques supposés des enseignants.
Les faits survenus à Lyon 2 mettent ainsi en évidence le rôle essentiel de l’accusation contre un professeur. Chacun a pu le voir dans l’enregistrement vidéo en direct assuré par les protagonistes, qui ont tenu à publiciser leur happening. Peu commenté et relevé, tant les faits et les images sont choquants par eux-mêmes, ce processus d’accusation par amalgame (« Racistes ! Sionistes ! C’est vous les terroristes ! ») s’avère crucial dans le mécanisme et la justification de l’attaque menée contre le professeur. En effet, dans l’accusation, la forme et le fond se confondent.
« Agression éthique »
Le thème de l’accusation agressive comme processus tragique et expression d’une justice archaïque a été étudié par un philosophe de la politique, François Tricaud, dans un essai sous-titré : « Recherche sur les figures de l’agression éthique. » Tout est dit dans cet oxymore qui résume le rôle purificateur et magique de l’acte d’accusation : entre l’accusateur et l’accusé, écrit l’auteur, s’établit « une sorte de vecteur polarisé où toute la pureté morale s’est portée à une extrémité et à l’autre toute l’impureté »4L’Accusation, Dalloz, 1977, p.27.. Le groupe de manifestants masqués et hurlants qui a fait irruption dans l’amphithéâtre de l’Université de Lyon 2 se sentait visiblement investi d’une mission et venait exercer de façon anomique sa propre conception de la justice réparatrice. Il a ainsi mis en œuvre un argument de rétorsion consistant à attribuer au géographe des crimes imaginaires tout en passant à l’acte par une transgression bien réelle.
François Tricaud qualifie l’accusation de « délire » et de « grand logos sauvage qui emplit l’histoire ». Il montre aussi que dans « l’interpellation agressive de l’homme par l’homme », l’accusation ouvre un cycle de violences en visant l’accusé dans sa personne entière. Professeurs ou idéologues, il n’y a plus de possibilité de différenciation du point de vue vengeur des étudiants.
L’Université, un « lieu de débat » ?
Depuis le 7 octobre 2023, plusieurs campus universitaires ont connu des tensions très vives affectant parfois durablement le climat de ces établissements, comme à Sciences Po Paris ou à l’Université de Strasbourg. Les étudiants juifs ont été contraints de « faire profil bas » puisqu’ils étaient désignés comme solidaires d’un « État génocidaire » : un amalgame qui leur dénie a priori toute liberté de pensée et d’opinion, et donc toute distance et souffrance à propos d’une guerre et d’une situation politique sur lesquelles leur avis n’est même pas audible, puisque prédéfini et imputé d’office.
L’Université n’a pas le monopole du débat mais celui de la controverse rationnelle et argumentée.
Au-delà de cette violence insidieuse dont on se demande comment elle peut être tolérée dans nos universités si soucieuses de leur image et si attentives, à juste titre, à toutes les formes de violence et de discrimination, les « comités Palestine » ont pu faire obstruction aux activités d’enseignement en menant des blocages qui ont empêché d’autres étudiants d’accéder aux lieux des cours pendant des semaines dans certains cas.
Devant ces faits de violences et ces illégalités manifestes, les responsables ont souvent du mal à prendre les mesures adéquates pour faire cesser des conflits, car ces décisions répugnent à leur éthique et à l’image idéalisée qu’ils se font d’un établissement d’enseignement supérieur. En témoigne l’argument très souvent invoqué en haut lieu : l’Université serait « un lieu de débat » et l’on passe alors « des universités » à « l’Université », pour signifier qu’il s’agit du principe fondateur et de l’Idée même de cette institution. Il est utilisé avec insistance comme s’il était doté d’un pouvoir naturel de pacification et de retour à la raison. Cependant, cet argument est surtout trompeur et démagogique. Car l’Université n’a pas le monopole du débat mais celui de la controverse rationnelle et argumentée qui repose sur le principe de la contradiction, se nourrit des savoirs objectifs et vise la recherche de la vérité menée en commun et avec sincérité.