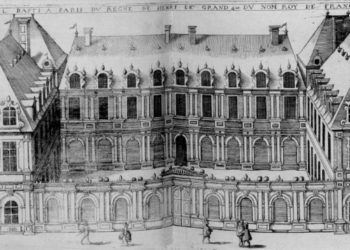Olivier Burtin, maître de conférences en civilisation des États-Unis à l’université de Picardie Jules Verne
Depuis que la police de l’immigration américaine s’est déployée en force à Minneapolis, une inquiétude ancienne a resurgi dans le débat public. De nombreuses voix se sont alarmées des menaces de Trump de recourir à l’Insurrection Act de 1807, qui donne le droit au président de déployer les forces armées sur le territoire domestique en temps de paix. Beaucoup y voient le franchissement d’une « ligne rouge » quasi sacrée qui séparerait nettement la guerre (à l’extérieur) du maintien de l’ordre (à l’intérieur). Cette représentation a une part de vérité institutionnelle et légale, mais elle décrit mal l’évolution réelle des pratiques. Car si le spectre de soldats déployés dans l’espace public continue de frapper les esprits, la focalisation sur ce Rubicon à ne pas franchir masque une transformation moins visible mais plus profonde : depuis au moins un demi-siècle, la frontière entre police et armée est de plus en plus poreuse aux États-Unis.
Un langage de guerre
Le tournant se joue d’abord dans les années 1960 et 1970. Les grandes révoltes urbaines provoquées par l’assassinat de Martin Luther King et le mouvement d’opposition à la guerre du Vietnam encouragent en réaction la montée d’un discours sur la « loi et l’ordre » qui applique un langage guerrier aux problèmes intérieurs. La « guerre contre le crime » lancée par le président Johnson, puis la « guerre contre la drogue » inaugurée par son successeur Nixon : ces formules ne sont pas de simples slogans. Elles installent l’idée qu’un phénomène social peut être traité comme un ennemi que l’on peut défaire en lui opposant des moyens d’exception. Dans les années 1970, la généralisation des unités de type SWAT (Special Weapons and Tactics) illustre cette mutation : conçues au départ pour des situations rares comme des tireurs embusqués ou des prises d’otages, elles se banalisent rapidement. Dans bien des villes, elles cessent d’être un instrument exceptionnel et deviennent un outil ordinaire, notamment pour les perquisitions liées aux stupéfiants. De plus en plus, les arrestations prennent la forme d’une irruption nocturne, casquée, armée, parfois sur la base d’informations fragiles, avec des conséquences tragiques quand la cible n’est pas celle qu’on croyait.
Ce n’est pas seulement l’équipement qui se militarise, c’est la manière de définir la situation et la propension à recourir à une force de plus en plus débridée.
Les années 1980 amplifient ce mouvement, dans un contexte de crise urbaine aiguë et de diffusion rapide de drogues dures comme la cocaïne. La police locale se dote de béliers, de fusils d’assaut, de protections balistiques, de véhicules adaptés à la guerre urbaine, ou encore d’hélicoptères. À une époque où les responsables politiques rivalisent de fermeté pour apparaître « tough on crime » [intraitables face au crime], la logique qui s’impose est celle du raid : frapper vite, fort, par surprise et en n’accordant que peu de respect aux droits des personnes interpellés, qui sont le plus souvent issues de minorités. C’est aussi une révolution culturelle. À mesure que l’on valorise la figure du policier-guerrier dans des films à succès comme Dirty Harry avec Clint Eastwood ou Cobra avec Sylvester Stallone, le citoyen, surtout dans les quartiers noirs ou latinos, est moins perçu comme un administré que comme un adversaire potentiel. Autrement dit, ce n’est pas seulement l’équipement qui se militarise, c’est la manière de définir la situation et la propension à recourir à une force de plus en plus débridée.
Une transformation déjà ancienne
Après le 11 septembre 2001, la dynamique change d’échelle. Au nom de l’antiterrorisme et de la « sécurité intérieure », des programmes de subventions et de transferts de matériel accélèrent la diffusion d’outils militaires : véhicules blindés, équipements de vision nocturne, armes et accessoires issus des surplus militaires passent aux mains des agents de police. La logique de la préparation au pire scénario possible d’attaque terroriste reconfigure des missions quotidiennes, amenant les agents à attacher moins d’importance à leur rôle de proximité. Paradoxalement, cela se fait souvent sans que la population en prenne pleinement la mesure, parce que ces équipements restent, la plupart du temps, hors champ. Ils ne deviennent visibles que lors des crises.
La ligne rouge a été entamée (…) quand l’exception s’est installée dans la routine.
On l’a vu en 1992, lors des émeutes de Los Angeles après le passage à tabac de Rodney King, puis surtout en 2014 à Ferguson, dans le Missouri, après que Michael Brown a été abattu par un officier : des policiers en tenue de combat, postés derrière des blindés, faisant face à des habitants et à des manifestants en colère. Les premiers étaient principalement blancs, les seconds majoritairement noirs. Beaucoup furent frappés par ce contraste, mais il n’avait rien d’inédit. Ce qui a sidéré l’opinion n’est pas né en 2014 : c’était la manifestation, en pleine lumière, d’une transformation lente et déjà ancienne. Même scénario à Minneapolis en 2020, après le meurtre de George Floyd : une mobilisation populaire suscite une réponse policière où grenades assourdissantes, lignes de forces casquées, armes dites « moins létales » et occupation massive de l’espace urbain donnent à la ville l’allure d’un véritable théâtre d’opérations.
Normalisation de la démesure
Ce long arrière-plan permet de lire autrement ce qui se joue aujourd’hui avec les menaces de Trump. Lorsque des forces fédérales interviennent avec des pratiques opaques (agents masqués, arrestations sans mandat, déportations illégales) et que le président menace d’avoir recours à l’armée, il est tentant d’y voir une rupture pure et simple. En réalité, ces séquences s’appuient sur un terrain déjà bien préparé : l’idée qu’un problème intérieur se traite comme une guerre ; l’acceptation d’une police équipée et entraînée selon des standards militaires ; l’habitude d’un maintien de l’ordre conçu comme une opération tactique ; et, plus largement, une culture politique où l’utilisation de moyens policiers démesurés devient de plus en plus normale.
C’est pourquoi la « ligne rouge » ne sera pas seulement franchie le jour où un uniforme militaire apparaîtra dans un parc ou à un carrefour. Elle a été entamée bien plus tôt, quand l’exception s’est installée dans la routine : quand les raids ont remplacé l’enquête patiente, quand l’équipement de combat a remplacé la présence dissuasive, quand l’ennemi intérieur a remplacé le citoyen. Minneapolis, dans cette perspective, n’est pas seulement un épisode contemporain : c’est un miroir tendu à cinquante ans d’histoire américaine, où la guerre, peu à peu, a servi de modèle au gouvernement de l’intérieur.