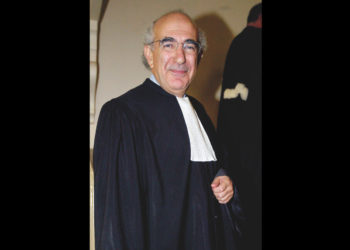Propos recueillis par Alain Barbanel et Dora Staub, journalistes
Près de trois mois après le massacre du 7 octobre, la guerre entre Israël et le Hamas fait toujours rage. L’objectif de Tsahal est d’éradiquer le Hamas. Est-ce envisageable et, dans ce contexte, peut-on imaginer une sortie de crise ?
L’opération militaire est plus difficile que beaucoup se l’imaginaient, avec un champ de bataille qui ne ressemble à aucun autre. La bande de Gaza est une forteresse au milieu d’une population extrêmement dense. Dans ce type de guerre asymétrique en général, et à Gaza en particulier, il est difficile de savoir à quel moment on peut crier victoire. Dans le nord de l’enclave, le Hamas a été effectivement privé de ses capacités politiques, administratives et militaires. Mais il y a encore beaucoup de cellules qui sont encore en mesure de faire des dégâts. Des individus émergent des tunnels ou des caves de façon très sporadique, de leur propre initiative puisque les lignes de communication avec leur commandement ont été coupées. Dans le centre et le sud, l’offensive est toujours en cours. La phase actuelle, l’offensive terrestre massive au niveau des corps d’armée, devrait se terminer d’ici à quelques semaines. La prochaine verra une réduction importante des troupes et des opérations terrestres et aériennes et se concentrera sur des incursions ponctuelles, avec notamment l’intervention de commandos pour éliminer les principaux chefs.
Cette guerre risque donc de durer encore longtemps…
Sous cette forme, oui, cela risque de prendre des mois. Cela dépendra de plusieurs facteurs, dont la capacité de résilience de la société et de l’économie israéliennes et la patience de notre ami américain. Cela dépendra aussi de la définition des buts de guerre. Si l’on entend « déradicaliser » le territoire, comme le prétend Netanyahou, autrement dit extirper l’idéologie du Hamas de la tête des Gazaouis, alors bonne chance ! Si l’on veut « seulement » empêcher le Hamas de menacer Israël et ramener les otages, c’est possible.
Si l’on entend « déradicaliser » le territoire, comme le prétend Netanyahou, autrement dit extirper l’idéologie du Hamas de la tête des Gazaouis, alors bonne chance ! Si l’on veut « seulement » empêcher le Hamas de menacer Israël et ramener les otages, c’est possible.
Vous avez toujours milité pour une solution à deux États. Très récemment, vous avez effectué une tournée en France et en Europe, rencontré des acteurs politiques auxquels vous avez présenté un plan de paix de la dernière chance. Quels sont les contours de vos propositions et le sens de cette « task force » que vous évoquez ?
L’idée est en effet de ressusciter la solution à deux États. Cet objectif, plus personne n’y croyait, or voici qu’il refait surface. C’est qu’il n’y a tout simplement pas d’autres solutions réalistes envisageables. Les deux autres alternatives – continuer à « gérer » le conflit, avec les résultats qu’on a vus, ou l’annexion pure et simple des Territoires – sont toutes deux intenables. Voilà pourquoi le monde entier, Américains en tête, redécouvre la solution à deux États. Mais comment y parvenir ? La méthode qui a prévalu depuis les Accords d’Oslo (1993) consistait à mettre face à face Israéliens et Palestiniens et à faciliter leur dialogue. Je préconise de renverser la perspective en imposant aux parties un cadre de règlement rigide. Après tout, tout, absolument tout a déjà été négocié au fil des ans dans les moindres détails…
Mais qui mettre autour de la table et avec qui négocier ?
Si les États-Unis, l’Europe et les pays arabes veulent en finir, il faut qu’ils se mettent d’accord sur ce qu’ils veulent et l’imposer aux parties prenantes. Très clairement, je pense qu’il ne s’agit plus de négocier avec les parties au conflit, mais de créer un front international auquel lesdites parties ne puissent pas s’opposer. Je constate qu’à chaque fois que les Américains ont vraiment voulu obtenir quelque chose d’Israël, ils l’ont obtenu ! C’est une question de donnant-donnant. Ce que nous avons (re)découvert avec l’attaque du 7 octobre, c’est qu’Israël n’a tout bonnement pas les moyens de se passer de l’aide américaine. Comment faire la guerre sans munitions ni pièces de rechange ? Il ne faut donc pas trop s’inquiéter de ce que Netanyahou veut ou ne veut pas. C’est aujourd’hui un leader faible, coincé entre la droite extrême de sa coalition et l’opinion publique qui ne veut plus de lui, et dont les jours au pouvoir sont comptés. Les Américains ont les moyens de hâter la chute de ce gouvernement en forçant Netanyahou à entrer dans un processus dont ses partenaires extrémistes ne voudront pas. Bref, il faut changer de méthode et tirer les enseignements de ce qui ne fonctionne pas depuis si longtemps.
C’est donc à la communauté internationale de s’imposer. Est-ce réaliste ?
La communauté internationale, en clair les Américains et leurs alliés, a su s’imposer quand elle l’a voulu, par exemple en faisant plier Milošević et sa clique dans le conflit en ex-Yougoslavie. Si l’on ne fait rien, Tsahal va réoccuper la bande de Gaza sans solution locale, ni administrative ni militaire, et l’on recommencera comme avant le 7 octobre, cette fois avec un territoire dévasté et anarchique. Nous aurons devant nous dix, vingt petits Hamas. Un nouveau Mogadiscio. Voilà les termes de l’équation telle que je la vois. Il faut donc agir très vite, car le « jour d’après », c’est demain.
Il s’agit donc d’envisager dans l’immédiat une bande de Gaza sans Hamas et sans Tsahal. Avec qui alors ?
Avec une force internationale militaire intérimaire, de préférence composée d’unités arabes ; une administration provisoire émanant de l’Autorité palestinienne, laquelle paie de toute façon des milliers de fonctionnaires à ne rien faire ; et une autorité politique, qui pourrait être un gouvernement provisoire de technocrates. Ce gouvernement serait chargé entre autres de lancer la reconstruction et d’organiser des élections présidentielles et législatives en vue d’une Autorité palestinienne « revitalisée », Biden dixit, qui aurait regagné par ce biais une légitimité populaire perdue depuis belle lurette. À terme, l’objectif est de créer enfin un État palestinien dans les territoires occupés, Cisjordanie et Gaza réunifiées. Comme je l’ai dit, la bonne nouvelle est que nous avons déjà des modèles de règlement longuement négociés dans les moindres détails. Les solutions sont à portée de main, et il faut la volonté politique pour les mettre en œuvre.
La méthode qui a prévalu depuis les Accords d’Oslo (1993) consistait à mettre face à face Israéliens et Palestiniens et à faciliter leur dialogue. Je préconise de renverser la perspective en imposant aux parties un cadre de règlement rigide. Après tout, tout, absolument tout a déjà été négocié au fil des ans dans les moindres détails…
L’Europe et surtout la France, avez-vous déclaré, doit-être la pièce maîtresse de ce dispositif ? Pour quelles raisons ?
Cela dépend ce qu’on entend par Europe. L’Union Européenne ? Lorsque je rencontre Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, il est évident qu’il ne peut pas s’exprimer au nom de l’ensemble de ses membres. Or, sans même évoquer l’attitude particulière de l’Allemagne, l’Irlande et la République tchèque n’ont pas du tout la même position sur la question du Proche-Orient. Alors, quand je parle de l’Europe, j’entends un groupe de pays de l’ouest du continent, Grande-Bretagne comprise, qui formeraient ce que j’appelle une coalition de volontaires qui travaillerait avec les Américains et les Arabes. La France, pièce centrale de l’Union et seul membre européen permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, pourrait en constituer le fer de lance.
Un attelage États-Unis-Europe-pays arabes est donc envisageable ?
Évidemment, rien ne peut se faire sans les États-Unis. Or, Washington est désormais tout à fait dans cette optique d’une solution à deux États. C’est désormais l’horizon indépassable. Mais ils ont besoin d’alliés. Seulement, il faut faire vite. Les élections présidentielles américaines sont pour cette année et rien ne nous assure que Donald Trump ne s’installera pas de nouveau à la Maison Blanche. Il importe donc d’exploiter une étroite fenêtre de tir, tant que Joe Biden et son administration, bien rodée et capable de travailler avec les Européens et les Arabes, sont encore aux manettes.
Sans Netanyahou ?
Sans Netanyahou, dont de toute façon les trois-quarts des Israéliens souhaitent la démission. Il est difficile de prévoir les modalités de sa chute – commission d’enquête, élections, pression de la rue, une combinaison des trois –, mais chute il y aura. De quoi sera faite la nouvelle équipe, qui sera à sa tête, tout cela est encore incertain, mais, quelle qu’elle soit, elle sera davantage ouverte à un processus de paix renouvelé.
Quel est le profil du futur dirigeant ? En a t-on déjà une idée dans le pays ?
L’homme le plus populaire actuellement est Benny Gantz, ancien chef d’État-major de l’armée, ancien ministre de la Défense et aujourd’hui membre du cabinet de guerre. C’est un centriste et un honnête homme. C’est lui qui a le plus de chances de prendre la tête de la prochaine coalition. Il aura fort à faire, avec un paysage politique éclaté et une opinion fortement polarisée. Cela dit, il ne faut pas exagérer le poids de l’opinion, dont les lignes de force sont, sauf aux extrêmes, fluctuantes. Les Israéliens ne sont pas forcément de gauche ou de droite ; la plupart se situent quelque part entre le centre-droit et le centre-gauche. Un leadership qui sait ce qu’il veut et où il va emportera leur adhésion. L’opinion a largement accepté Oslo, il ne faut pas l’oublier. Il y aura des poches de résistance dans la partie de la population qui est gagnée aux idées de l’extrême-droite messianique et dont les plus excités seront tentés par la violence.
Le risque d’embrasement en Cisjordanie est sérieux avec la présence de colons de plus en plus virulents. Vous avez évoqué un risque de guerre civile si ces colons armés évalués à plus de 500 000 doivent être délogés. Est-ce une éventualité sérieuse ?
Oui, hélas. Il y a déjà eu des heurts en 2005 avec le désengagement de la bande de Gaza, mais il y avait moins de 8 000 colons. On est aujourd’hui dans une autre dimension, avec des risques de violence autrement importants. Hors Jérusalem, la population des implantations compte en effet environ un demi-million d’âmes. Mais ils ne sont pas tous prêts à se battre les armes à la main pour s’y accrocher, loin s’en faut. La plupart sont des ultraorthodoxes et des juifs traditionalistes, voire séculiers, qui y ont trouvé à se loger à des conditions plus avantageuses que de ce côté-ci de la Ligne verte. Ceux-là vivent dans des colonies situées le long de la Ligne verte, dans une bande de territoire dont tous les différents modèles de règlement prévoient l’annexion à Israël en échange de terres prélevées sur notre territoire souverain. Mais quelque 100 000 individus, dont quelques milliers de radicaux armés, vivent au cœur de la population palestinienne. Déloger ceux-là ne sera pas une partie de plaisir. L’armée fera ce que l’autorité civile lui dira de faire, mais ce sera affreux.
Il y a déjà eu des heurts en 2005 avec le désengagement de la bande de Gaza, mais il y avait moins de 8 000 colons. On est aujourd’hui dans une autre dimension, avec des risques de violence autrement importants. Hors Jérusalem, la population des implantations compte en effet environ un demi-million d’âmes.
Vous impliquez les pays arabes dans le règlement de ce conflit et envisagez que l’Arabie Saoudite, qui devait signer les accords d’Abraham, soit à la manœuvre. Les événements actuels ne risquent-ils pas de mettre à mal ce projet ?
Au contraire, je pense qu’ils y contribuent. En effet, il faut une force multinationale arabe avec un mandat de l’ONU qui soit acceptée par la population locale. Il y a des pays arabes avec lesquels nous avons déjà des accords de paix – l’Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc. Et l’Arabie Saoudite, avec laquelle nous étions près de conclure. Ces pays ont intérêt à stabiliser le territoire, car ce qui se passe là-bas secoue leurs régimes. Et ils ont intérêt à une solution politique à long terme de cette crise. Voilà le message que j’essaie de faire passer à Bruxelles ou à Paris.
Mais comment réunir la Cisjordanie à la bande de Gaza géographiquement et géopolitiquement pour que cet État palestinien soit viable ?
Nous disposons de modèles de règlement de cet aspect – une route extraterritoriale par exemple. Ce n’est pas idéal, mais on ne peut rien contre la géographie. L’important est de donner au gens sur place un horizon d’espoir en leur montrant qu’on peut sortir du cycle infini de la guerre et de la misère. C’est un pari qui me semble raisonnable. La plupart des gens ne vivent pas d’idéologie. Ils veulent gagner leur vie, éduquer leurs enfants, leur assurer un avenir. C’est là-dessus qu’il faut capitaliser. C’est pour cela qu’Oslo à été finalement bien perçu à l’époque, par les Israéliens et les Palestiniens, excepté chez les excités des deux côtés. La grande erreur, le péché d’Oslo, a été de leur permettre de saboter le processus, les uns par le terrorisme, les autres par la colonisation. Oslo n’est pas mort de sa belle mort, il a été assassiné. Mais le cadavre bouge encore. L’Autorité palestinienne est mal en point mais toujours là, et la reconnaissance mutuelle des deux mouvements nationaux reste une réalité irréversible. C’est un acquis non négligeable.
Ne craignez-vous pas que cette violence déployée pour éradiquer le Hamas, qui fait un grand nombre de victimes parmi les civils, ne nuise sur le long terme à l’image d’Israël ?
Cela a toujours été le cas. Ce qui est nouveau, du moins à Gaza, c’est l’ampleur de l’opération et donc le nombre des victimes. Comme je vous l’ai dit, c’est un champ de bataille pareil à nul autre. Le Hamas est terré en sous-sol dans un réseau inédit de tunnels, et, en surface, parmi la population civile. Il s’en sert comme bouclier humain. Ce n’est pas de la propagande israélienne, c’est un fait. Le Hamas se fiche comme d’une guigne du sort de sa propre population. Quand j’ai l’occasion de parler à des Européens, je leur explique qu’on on ne peut pas vivre avec un voisin pareil dont la raison d’être est de violer votre femme et de brûler votre maison. En fait, c’est la même chose avec le Hezbollah dans le nord.
C’est un champ de bataille pareil à nul autre. Le Hamas est terré en sous-sol dans un réseau inédit de tunnels, et, en surface, parmi la population civile. Il s’en sert comme bouclier humain.
Mais comment expliquer que le gouvernement de Netanyahou ait accepté que ce groupe terroriste soit financé par l’extérieur, notamment par le Qatar ? Pour affaiblir l’Autorité palestinienne ?
C’est vrai et ce n’est pas le moindre de ses péchés. Quelles que soient les erreurs que nous avons tous commises, y compris l’Europe qui a continué à nourrir le monstre, la faute est d’abord celle de Netanyahou et Cie. Et l’on se réveille un jour, le 7 octobre, avec ce massacre innommable. Que faire dès lors ? Éliminer le Hamas d’abord et faire le ménage ensuite chez nous avec un nouveau cap, une nouvelle vision. Et malheureusement, avec un prix lourd à payer en vies humaines.
Je ne dis pas cela de gaîté de cœur, c’est épouvantable, mais il faut que les gens comprennent. Ils voient de l’extérieur ce qui se passe et comptent les morts, quelque vingt mille au moment de cet entretien1Chiffres fournis par le Hamas, ndlr.. Parmi eux, pas mal de terroristes, un tiers selon Tsahal. Mais cela, le ministère de la Santé du Hamas ne le dit pas.
Quoi qu’il en soit, comment faire autrement ? Qu’ont fait les Américains et la coalition internationale pour éradiquer l’État islamique à Falloujah, à Mossoul et ailleurs ? Ce sont les fruits empoisonnés de la guerre urbaine, du combat antiterroriste, de toute guerre asymétrique.
Ce qui aggrave notre cas, c’est que nous n’offrons aucun horizon d’espoir. Imaginons que le gouvernement d’Israël dise quelque chose comme : « Écoutez, ce que nous faisons est terrible, nous n’en sommes pas heureux, mais nous n’avons pas le choix. Cependant nous sommes conscients que ce n’est pas la solution, et nous aspirons à un règlement politique du conflit. » Tout serait différent, y compris la manière dont l’opinion publique mondiale nous perçoit.
Quels seraient les risques d’un nouvel échec du processus de paix ?
Si rien n’est fait, je prévois vraiment un avenir très sombre, pour ce pays, pour les Palestiniens et pour la région. On continuera de vivre avec un baril de poudre à Gaza, et un deuxième en Cisjordanie qui risque, lui aussi, d’exploser à tout moment. Il ne faut pas se faire d’illusions, une troisième Intifada n’est pas une vue de l’esprit. Sans oublier celui qui nous guette à la frontière nord, au sud-Liban, et désormais en Syrie, en Irak, et jusqu’au Yémen ! Et n’oublions pas l’Iran… Le rêve d’insertion d’Israël dans la région sera enterré pour de bon, et nous aurons une longue période de troubles et de violences, avec à la clef un gouvernement fascisto-messianique à Jérusalem. Bref, un avenir ou des gens comme moi ne pourraient plus vivre dans leur propre pays. L’historien que je suis est aussi un citoyen, qui ne saurait se résoudre à une telle vision de cauchemar. Abba Eban, le mythique ministre des Affaires étrangères israélien avait coutume de dire que « Les nations ne se résolvent aux solutions raisonnables qu’après avoir essayé toutes les autres. » On a essayé toutes les autres ; il est temps de se résoudre à la seule solution raisonnable.
Si rien n’est fait, je prévois vraiment un avenir très sombre, pour ce pays, pour les Palestiniens et pour la région. On continuera de vivre avec un baril de poudre à Gaza, et un deuxième en Cisjordanie qui risque, lui aussi, d’exploser à tout moment.
En toute franchise, y avait-il une alternative à cette guerre meurtrière, après le massacre du 7 octobre ?
Non, après une attaque pareille, franchement il n’y en n’avait pas. Je discutais avec un ami philosophe pour qui il aurait fallu s’abstenir de réagir militairement, du moins dans l’immédiat, et se concentrer sur un objectif unique : échanger tous nos otages contre tous leurs prisonniers. Dans l’abstrait, cet homme a peut-être raison. Mais dans la situation concrète où nous nous trouvions, après une attaque pareille, alors que notre capacité de dissuasion était en miettes et que le pays était tétanisé de colère, d’incompréhension, de soif de vengeance aussi, pouvait-on imaginer qu’Israël ne réagisse pas ?
Comment expliquez-vous l’ « importation » de ce conflit en Occident avec les dérapages antisémites que l’on connaît ?
C’est une question qui m’a toujours interpelé, en tant qu’étudiant à Paris, historien, ambassadeur enfin. Je crois qu’il y a plusieurs éléments de réponse. D’abord, le fait que cette terre est constitutive de la conscience de l’Occident chrétien. La Palestine n’est pas la Tchétchénie. Ensuite, l’Europe, et la France en particulier, abritent de grosses communautés juives et musulmanes, qui sont autant de caisses de résonance des soubresauts du Proche-Orient. Aussi, le Palestinien sert depuis longtemps de substitut à d’autres figures de l’opprimé mondial, le Vietnamien, par exemple, ou l’Algérien, dès lors que ces conflits ont trouvé leur règlement. À cela viennent se greffer les fantasmes postcoloniaux et « décoloniaux ». Israël passe pour être l’avant-poste de l’Occident au cœur de ce qu’on appelait autrefois le tiers-monde. Enfin, le conflit israélo-palestinien est fantasmé en Occident comme substitut au mal-être des populations immigrées. Nous servons ainsi de point de fixation fantasmé de tous les conflits à l’œuvre au sein des sociétés occidentales, notamment en France. C’est pour cette raison que d’autres horreurs, qui sont infiniment plus coûteuses en vies humaines, retiennent moins l’attention, même quand il s’agit de musulmans. C’est quand même extraordinaire ! Quand le régime d’Assad fait le siège du camp de Yarmouk aux portes de Damas et affame les Palestiniens qui y sont enfermés, il n’y a pas une protestation, pas un manifestant, rien. Alors que tout ce qui se passe ici enflamme le monde entier.
Et que peut-on faire pour y remédier ?
D’abord lutter contre l’ignorance ! Je suis frappé par l’incroyable inculture des gens qui parlent de ce conflit. Quand vous voyez de jeunes Américains qui brandissent des pancartes « From the River to the Sea » et qui n’ont pas la moindre idée de quelle rivière et de quelle mer il s’agit… Comment voulez-vous entamer un débat dans ces conditions ? Où se trouve la Palestine sur la carte, d’où vient Israël, quelles sont les racines du conflit qui les oppose, combien sont-ils ? Des étudiants que j’ai eus jadis à Montréal pensaient qu’Israël était aussi grand que le Canada et comptait 180 millions d’habitants ! Un peu de savoir ferait-il la différence ? Si seulement j’en étais certain…